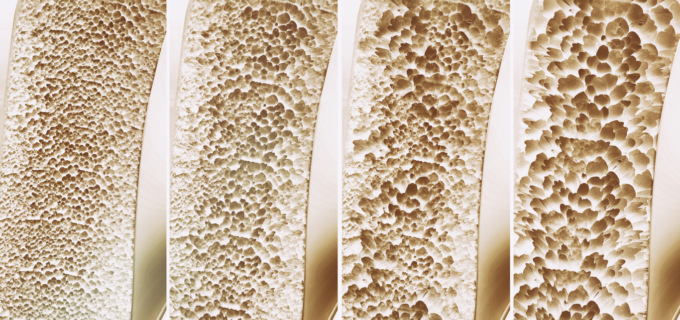- Accueil ›
- Thérapeutique ›
- Médicaments ›
- Recherche et innovation ›
- Quelle mention décroche la recherche française ?
Quelle mention décroche la recherche française ?
Si elle se fragilise, la recherche hexagonale en biologie-santé peut s’enorgueillir de son expertise dans certains domaines comme la cancérologie, les neurosciences ou les maladies rares. Ils ont en commun une structuration de la filière de soins, une coordination de la recherche et une volonté affichée des pouvoirs publics.
Historiquement, la France a concentré ses efforts de recherche sur la physique et les mathématiques, des sciences dures. Pour autant, grâce à sa recherche hospitalo-universitaire et à ses institutions publiques contribuant à faire progresser la science et la technologie (le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ou CEA, le Centre national de la recherche scientifique, ou CNRS, et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou Inserm, figurant dans le top 10 selon le classement annuel Thomson Reuters), elle excelle dans certaines disciplines : l’oncologie, les maladies rares, l’infectiologie ou les neurosciences, notamment.
Derrière un chercheur, une organisation
« La recherche médicale, c’est avant tout des soignants, une excellence des formations, une dynamique des équipes et une mobilisation des sociétés savantes, académies et universités », résume le Pr Didier Samuel, du Comité national de coordination de la recherche (CNCR). C’est donc d’abord de ce côté qu’il faut chercher les explications. Les grandes découvertes historiques, liées à des chercheurs de renom, ont souvent posé les bases d’une recherche d’excellence, autour desquelles la recherche s’est progressivement structurée, préservée par des politiques adaptées de financement. L’infectiologie est en cela emblématique. Dans le sillon de Louis Pasteur, par exemple, s’est construit un tissu de structures de recherche dense et renommé (Institut de recherche pour le développement ou IRD, Instituts Pasteur, etc.), qui ont conduit à de nombreuses découvertes (BCG, vaccin contre l’hépatite B, VIH, etc.).
En neuroscience, « de grands noms – Charcot, Fessard ou Pierron, qui se sont chacun consacré à un pan de la discipline, ont favorisé son essor et les structures dans lesquels ils étaient investis ont perduré. Celles-ci bénéficient d’une reconnaissance internationale où l’émulation est favorable à la recherche fondamentale comme aux progrès thérapeutiques », raconte Jean-Gaël Barbara, neuroscientifique au CNRS. Par exemple, la Pitié-Salpétrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), qui accueillit la première chaire de neurologie de Charcot et la première opération du cerveau, a été le berceau de l’Institut du cerveau (ICM) créé en 2010, et qui regroupe patients, soignants, laboratoires multidisciplinaires, plateformes technologiques et incubateur de start-up. « Dans le contexte de forte concurrence internationale, de telles structures permettent de maintenir une force de frappe, de concentrer les financements et de créer une émulation favorisant l’implémentation des progrès technologiques », conclut-il.
Des moyens et une ligne claire
L’engagement des décideurs publics est évidemment un corollaire déterminant, lorsqu’il est correctement financé et coordonné. Si les neurosciences en ont bénéficié via des périmètres et des ambitions disparates (plans Alzheimer, Parkinson, maladies neurodégénératives), deux autres disciplines sont bien plus emblématiques : le cancer et les maladies rares.
« Derrière “plan”, il faut entendre “politique coordonnée”, précise Ségolène Aymé, généticienne à l’Inserm. En la matière, les premiers plans cancer et maladies rares ont vraiment abordé leur discipline de façon transverse, pour intégrer tous les éléments nécessaires à une lutte efficace contre ces maladies, depuis la prévention jusqu’à la recherche. » Ces plans, assortis de financements importants et d’un réel pilotage, ont pris place dans un tissu déjà vif de soin et de recherche, mais ils ont dessiné une feuille de route qui en ont renforcé l’efficacité : « Le plan maladie rares a, par exemple, structuré la filière de soins dans le domaine, ce qui est nécessaire à la qualité de la prise en charge mais aussi à l’existence d’une recherche dynamique », précise-t-elle. C’est à cette époque qu’ont été créés les centres de référence maladies rares (CRMR) ou les centres de compétences. « La France est maintenant reconnue comme le pays le mieux organisé dans ce domaine. Et dans ces filières bien structurées, la proximité des malades et des chercheurs permet l’existence de registres, de bases de données et de files active dont l’ampleur est indispensable à une recherche de qualité. »
En oncologie, aussi, notamment grâce à la structuration ancienne de la filière de soins entre centres de lutte contre le cancer et centres hospitaliers/centres hospitaliers universitaires, le tout étant piloté par l’Institut national du cancer (INCa), la France occupe aujourd’hui le premier rang européen et le troisième mondial en nombre d’essais cliniques de cancérologie.
Rapprochements public-privé
Le rapprochement des acteurs de la recherche sur un même lieu ou un même territoire facilite donc le progrès et l’innovation. L’un des premiers efforts en ce sens a été adopté en 2004 avec la création des pôles de compétitivité, dont l’ambition territoriale est désormais européenne. Il existe sept pôles principaux en biologie-santé, comme Medicen, LyonBiopôle ou Cancer-Bio-Santé.
Plus récemment, les instituts hospitalo-universitaires (IHU) créés par le programme d’investissements d’avenir en 2009 ont conduit à la labellisation de plusieurs pôles d’excellence français en recherche, en soins, en formation et en transfert de technologies sur la base d’expertises confirmées en génétique, en cardiologie, en chirurgie, en neurologie (ICM), en cardiométabolisme et en vision. Cette année seront aussi lancés les premiers hubs ou bioclusters. « Ils sont calqués sur le modèle américain. Leur ambition est de rapprocher encore plus les expertises publiques et privées, au travers de guichet unique, facilitant les innovations en accueillant entreprises et partenaires publics sur un même lieu », précise Thomas Borel, directeur des affaires scientifiques au Leem (Les Entreprises du médicament). Les premiers projets concernent l’oncologie (Ile-de-France), l’infectiologie (Rhône-Alpes) ou l’immunologie (Bouches-du-Rhône).
L’innovation clinique est désormais le cœur des politiques publiques en biologie-santé. Parallèlement aux progrès réalisés sur le plan administratif, de nouveaux investissements sont annoncés : le plan innovation santé –transversal – vise à investir 1 milliard d’euros pour porter la recherche biomédicale autour d’équipes d’excellence, avec un effort spécifique dans les biothérapies et bioproductions de thérapies innovantes, la santé numérique, les maladies infectieuses émergentes et les nouvelles menaces. « Cela crée un écosystème favorable, notamment pour les approches les plus innovantes, comme la healthtech, qui est très dynamique en France », reconnaît Franck Mouthon, président de l’association France Biotech. Ces entreprises de biotechnologies, nouveaux dispositifs médicaux, outils de diagnostic, d’imagerie et d’intervention… sont nombreuses sur le territoire et la majorité d’entre elles collaborent avec la recherche académique, universitaire et hospitalière. « D’ailleurs, la moitié d’entre elles sont créées sur la base de travaux issus de la sphère publique, et même les deux tiers de celles de biotechnologies », poursuit-il. Preuve que le transfert fonctionne, en tout cas, de plus en plus. Pour cela, il existe des organismes publics ou des sociétés spécifiques dévolues au transfert de technologies vers la sphère privée, ainsi que des leviers financiers de plus en plus nombreux (fonds d’investissement, banques publiques d’investissement, crédit impôt recherche, concours d’innovation i-Lab, etc.). « Parce qu’elles sont efficaces, ces collaborations sont le plus souvent maintenues au long cours », conclut-il.
Un hic toutefois. La majorité des efforts annoncés restent axés sur la recherche appliquée. La recherche fondamentale est moins concernée, voire oubliée. Le budget des structures publiques continue à diminuer. « Il ne faudrait pas passer en deçà d’un seuil critique, qui serait délétère pour la recherche appliquée », prévient Ségolène Aymé. Ce que, pour l’heure, les annonces actuelles ne semblent pas enclines à contrebalancer.
- Analogues du GLP-1 : le conseil constitutionnel impose au médecin d’informer de la non-prise en charge
- Préparations magistrales de quétiapine : un nouveau tableau d’équivalence de doses
- Interactions avec les produits à base de CBD : quels médicaments ?
- Quétiapine : pas de retour à la normale avant l’automne
- Neutraderm gel douche : retrait de lots
- Nouvelles missions : l’offre et la demande sont au rendez-vous
- Rapport de l’Igas : le DPC est (sans doute) mort, vive la certification !
- Biosimilaires : vers un taux de remise à 30 % ?
- Aggravation des tensions sur Pegasys : nouvelles règles de dispensation mises en place
- [VIDÉO] Régulation de l’installation des médecins, un poisson d’avril ?