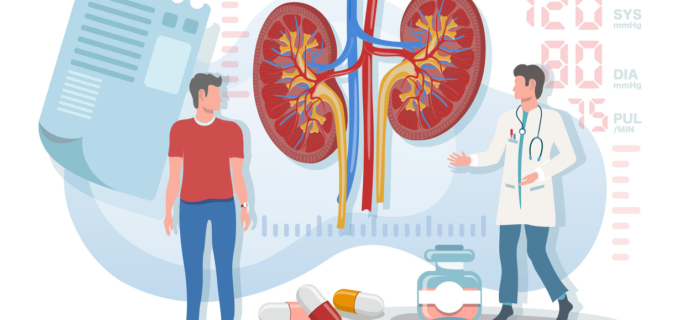- Accueil ›
- Thérapeutique ›
- Médicaments ›
- Recherche et innovation ›
- Les 4 étapes de la pharmacocinétique
Les 4 étapes de la pharmacocinétique
Le devenir du médicament dans l’organisme s’articule en 4 étapes que sont l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination.
Absorption
C’est le processus par lequel le principe actif passe, sous forme dissoute, de son site d’administration au sang.
Pour cela, le principe actif doit traverser une membrane biologique, soit par diffusion passive dans le sens du gradient de concentration, soit par l’intermédiaire de protéines qui servent de transporteurs. Il existe des protéines d’influx qui facilitent l’entrée des médicaments dans les cellules et des protéines d’efflux comme la P-glycoprotéine (P-gP) qui, au contraire, expulsent les médicaments hors des cellules. La P-gP s’oppose à l’absorption intestinale de certains médicaments.
La biodisponibilité correspond à la fraction exprimée en pourcentage de la dose administrée qui est parvenue au sang, sous forme inchangée, et qui est donc réellement disponible pour exercer un effet thérapeutique.
L’absorption dépend : – des caractéristiques physicochimiques du principe actif (caractère ionisable, solubilité, poids moléculaire) ; – de la voie d’administration : l’effet de premier passage hépatique auquel sont soumis les médicaments administrés par voies orale et rectale diminue la biodisponibilité ; en intraveineuse (IV), elle est de 100 % ; – de paramètres liés au patient : génétique (déterminant l’activité des transporteurs), vitesse du transit intestinal, interactions médicamenteuses (topiques digestifs, cations métalliques, inhibiteurs de P-gP, etc.).
Distribution
C’est la diffusion du médicament dans l’organisme. Elle comprend 2 phases : – Phase plasmatique : les principes actifs circulent dans le sang, soit liés aux protéines plasmatiques (comme l’albumine et l’alpha-1-glycoprotéine acide), soit libres. La forme libre est active, car diffusible. La forme liée est inactive pharmacologiquement, mais c’est une forme de réserve, les liaisons étant réversibles. Les principes actifs liposolubles, comme les antivitamines K (AVK) ont une forte affinité pour les protéines plasmatiques. – Phase tissulaire : le médicament quitte le sang et gagne différents organes par la diffusion tissulaire. Cette phase dépend des caractéristiques physicochimiques des médicaments et de la vascularisation des organes. Certaines barrières protègent les organes richement vascularisés, comme la barrière hémato-encéphalique difficilement franchissable par les médicaments.
Le volume de distribution (Vd) est un volume théorique fictif exprimé en litres, dans lequel se distribue le médicament. Il permet d’apprécier la capacité d’un principe actif à diffuser. Un médicament diffuse d’autant mieux que son volume de distribution est grand (cas des médicaments liposolubles). Inversement, un médicament qui a tendance à rester dans le compartiment sanguin (médicament hydrosoluble) a un volume de distribution plus faible.
Métabolisme
C’est l’étape de transformation hépatique du médicament en métabolites plus hydrosolubles, donc plus faciles à éliminer par les reins. Le plus souvent, les métabolites sont inactifs, mais ils sont parfois plus actifs que la molécule administrée (cas des prodrogues) et peuvent aussi être toxiques (cas du paracétamol et de l’isoniazide, dont les métabolites sont hépatotoxiques, ou du cyclophosphamide, dont le métabolite est urotoxique).
Les réactions de phase I, dites de fonctionnalisation, consistent en des oxydations, des réductions ou des hydrolyses. Les réactions d’oxydation sont catalysées par les cytochromes P450 (CYP).
Les réactions de phase II, dites de conjugaison (acétylation ou glucuronoconjugaison par exemple), permettent de transférer un groupement polaire sur les métabolites issus de la phase I pour augmenter leur hydrosolubilité.
Le métabolisme est influencé par des facteurs génétiques (l’activité des CYP est génétiquement déterminée), par l’insuffisance hépatique ou cardiaque (qui diminue la perfusion hépatique), par l’âge du patient et par des interactions avec les inducteurs ou inhibiteurs des cytochromes P450.
Elimination
C’est l’excrétion du médicament, principalement par voie rénale (dans les urines) et hépatique (excrétion par la bile et élimination dans les fèces). Les voies pulmonaire, sudorale, salivaire, lacrymale et lactée sont des voies secondaires d’élimination.
Les reins éliminent grâce à la filtration glomérulaire et à la sécrétion tubulaire.
La filtration correspond à la première phase de formation de l’urine. C’est un processus passif. Seules les formes libres peuvent être filtrées.
La sécrétion tubulaire est un phénomène actif via les transporteurs. Les protéines d’efflux comme la P-gP favorisent la sécrétion de certains médicaments dans les urines, au niveau du tube contourné proximal.
La clairance (Cl) caractérise la capacité à éliminer. C’est le volume de plasma (en ml) épuré d’une substance par unité de temps (en min). Elle est indépendante de la dose administrée, mais dépend de paramètres liés au patient (âge, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque modifiant la perfusion des reins).
La demi-vie (t1/2) évalue la vitesse d’élimination du médicament. C’est le temps au bout duquel la concentration plasmatique d’un médicament en phase d’élimination a diminué de moitié. Il faut 5 demi-vies pour qu’un médicament soit considéré comme totalement éliminé ou pour atteindre, en administrations répétées, l’état d’équilibre (ou steady state), c’est-à-dire l’état où la quantité éliminée et la quantité administrée se compensent.
La demi-vie dépend des caractéristiques physico-chimiques du médicament (et varie donc d’un médicament à l’autre, même au sein d’une même famille thérapeutique) et des capacités d’élimination du patient. Elle est définie par la formule : t1/2 = (Vd/Cl) x 0,693.
Chez le sujet âgé, la masse grasse s’étend au détriment de la masse maigre, et le volume de distribution des médicaments liposolubles augmente, ainsi que leur demi-vie.
De même, en cas d’altération rénale ou hépatique, la clairance diminue et la demi-vie des médicaments est allongée.
- Sources : Collège national de pharmacologie médicale, pharmacomedicale.org ; « La barrière hémato-encéphalique », iPubli Inserm, ipubli.inserm.fr ; Guide pharmaco clinique, R. Gervais, G. Willoquet, M. Talbert, Les éditions du Moniteur des pharmacies ; Interactions médicamenteuses : mécanismes et analyse de cas , D. Le Gueut, Les éditions du Moniteur des pharmacies .
- Miorel et génériques : contraception obligatoire pour tous
- Quétiapine : vers la dispensation à l’unité et des préparations magistrales
- 3 000 patients bénéficieront de Wegovy gratuitement
- Médicaments à base de pseudoéphédrine : un document obligatoire à remettre aux patients
- Ryeqo : traitement de l’endométriose en 5 points clés