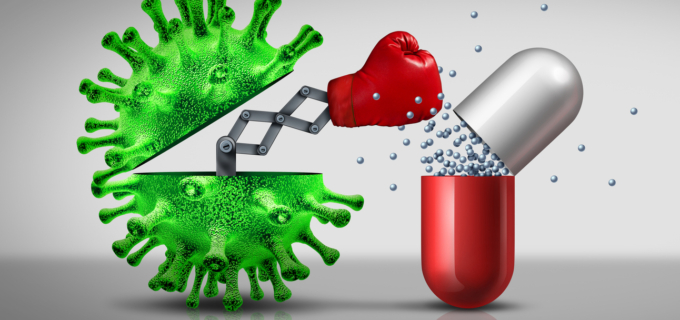- Accueil ›
- Préparateurs ›
- Savoirs ›
- Les anesthésiques locaux
Les anesthésiques locaux
Utilisés en vue d’une intervention chirurgicale, d’un examen ou d’un traitement douloureux, les anesthésiques locaux peuvent engendrer des effets indésirables systémiques graves. Respecter les posologies et les indications limite ce risque.
Deux groupes de produits
• La chimie. Les anesthésiques locaux (AL) sont formés d’un noyau aromatique et d’une fonction amine reliés par une chaîne intermédiaire dont la nature définit deux groupes : les amino-esters (cocaïne, procaïne) et les amino-amides (lidocaïne, prilocaïne…).
• Ses conséquences. La longueur et la structure de cette chaîne influencent la liposolubilité, la liaison aux protéines plasmatiques et la stabilité (moindre pour les esters facilement dégradés), et par conséquent le délai, la puissance et la durée d’action des différents produits, mais aussi leur toxicité (pouvoir allergisant supérieur pour les esters).
Mode d’action commun
Les anesthésiques locaux bloquent de manière réversible la conduction dans les fibres nerveuses (sensitives, motrices, végétatives), rendant temporairement insensible le territoire où ils sont administrés, avec, dans l’ordre, une diminution des sensations douloureuses, thermiques puis tactiles. Ils agissent au niveau des canaux sodiques membranaires en diminuant la perméabilité aux ions Na+ impliqués dans la propagation et l’amplitude des potentiels d’action.
Seuls ou associés
Les anesthésiques locaux sont commercialisés associés, pour potentialiser leur activité (lidocaïne + prilocaïne) ; avec un vasoconstricteur (naphazoline, adrénaline), pour limiter la diffusion systémique du produit et prolonger sa durée d’action en augmentant sa rémanence.
Anesthésies locales et loco-régionales
Les AL sont indiqués en vue d’abolir la sensibilité d’une partie du corps pour une intervention chirurgicale, un examen ou un traitement.
• Anesthésies locales : de surface ou de contact sur la peau ou sur les muqueuses en prévision de gestes douloureux (injection, fibroscopie, ponction, petite chirurgie, soin des plaies…) ou par infiltration intradermique ou sous-cutanée au voisinage d’un nerf.
• Anesthésies loco-régionales. Le produit est injecté au voisinage d’un tronc ou d’un plexus nerveux (réseau de nerfs) ou de la moelle épinière (rachianesthésie et péridurale) afin d’obtenir un bloc sensitif et moteur localisé (gestes chirurgicaux en orthopédie, traumatologie, obstétrique…). Une administration intraveineuse locale en aval d’un garrot est possible dans certaines chirurgies des membres supérieurs ou du pied.
Effets indésirables systémiques possibles
• Locaux : pâleur, érythème, oedème, brûlures, démangeaisons, picotements lors d’applications cutanées ou sur les muqueuses. Hématome, paresthésie (fourmillements), nécrose et infections aux sites d’injection.
• Systémiques. Ces effets sont liés à la diffusion des anesthésiques locaux dans la circulation sanguine, notamment en cas d’injection intravasculaire accidentelle ou de surdosages, y compris en application cutanée :
– troubles neurologiques : troubles visuels, tremblements, acouphènes, convulsions, coma ;
– troubles cardiaques : diminution de la conduction et de la force de contraction, hypotension, choc ;
– dépression respiratoire, renforcée par la présence éventuelle de vasoconstricteurs.
• Allergiques. Rares mais potentiellement graves, ils sont liés aux principes actifs ou aux excipients (méthylparaben, sulfites) à titre d’érythème, urticaire, eczéma, voire de choc anaphylactique.
Contre-indications
• Générales : hypersensibilité aux anesthésiques locaux ; méthémoglobinémies congénitales ou idiopathiques, porphyrie (déficit d’enzymes intervenant dans la synthèse de l’hémoglobine), anémie hémolytique et médicaments méthémoglobinisants (sulfamides, métoclopramide) qui potentialisent l’effet élévateur de la méthémoglobine propre aux anesthésiques locaux ; troubles de la conduction cardiaque, HTA sévère ; épilepsie non contrôlée ; zone infectée, enflammée (application locale).
• Liées aux techniques : ne pas utiliser un vasoconstricteur pour l’anesthésie locale des extrémités (doigts, orteils, verge…) pour limiter le risque de nécrose par ischémie.
Gare aux surdosages
Les surdoses potentialisent le risque d’effets indésirables systémiques.
• Respecter les posologies recommandées. Y compris lors des applications locales, exprimées en quantité et en surface en centimètres carrés couverte selon l’âge et l’indication. Une réduction de posologie peut être nécessaire, notamment chez les enfants en bas âge, en cas de dermatite atopique, lors d’application sur les muqueuses génitales… Ne pas répéter les applications, en particulier chez l’enfant jeune.
• Respecter les temps de contact. Le délai total recommandé débute au moment de l’application et se termine au moment du retrait.
• Repérer les utilisations inappropriées. Troubles cardiaques et convulsions ont été rapportés (deux décès aux États- Unis) lors d’utilisation étendue de crèmes anesthésiques cutanées en vue de gestes cosmétiques (épilation au laser, tatouages étendus…). Ces prescriptions hors AMM (non remboursées) doivent faire l’objet de mises en garde à l’officine.
• Autres précautions. Éviter toute alimentation solide ou liquide pendant deux heures en raison du risque de fausse route après anesthésie buccopharyngée- laryngée. Les AL peuvent induire une réaction positive aux tests antidopage.
Mode d’emploi d’Emla
• Pour la crème. L’appliquer en couche épaisse sur la zone à traiter et recouvrir d’un pansement adhésif (sur la peau) ou non (sur les muqueuses génitales) ;
• Pour le patch. Appliquer de manière à ce que la pastille blanche recouvre la surface à anesthésier sans appuyer sur la partie centrale mais sur le pourtour adhésif pour éviter le risque de fuite du produit ; indiquer l’heure d’application sur le pansement.
• Précautions. S’assurer que la personne qui prodigue les soins à un jeune enfant prévienne le risque d’ingestion accidentelle (crème ou patch léché) et le surveille pendant et après l’administration : risque accru de méthémoglobinémie (cyanose, bradycardie, hypotension…). Ne pas apposer près des yeux (irritation cornéenne) ; en cas de contact accidentel, rincer l’oeil avec de l’eau et le protéger jusqu’à ce que la sensibilité revienne. Ne pas appliquer dans le conduit auditif externe si le tympan est lésé ou doit être perforé, ni sur les muqueuses génitales de l’enfant (données insuffisantes).
• Interactions. Ne pas utiliser avant injection de vaccins vivants comme le BCG (les AL inhibent la croissance virale et bactérienne).
Particularités
• Le blocage de la conduction nerveuse est théoriquement limité à un territoire défini.
• La diffusion sanguine est possible avec effets indésirables graves à la clé.
• Risque accru en cas de surdosage, y compris lors d’application cutanée.
• Accidents toxiques graves rapportés en cas d’utilisation inappropriée.
• Surveillance accrue chez les enfants sujets à une ingestion accidentelle et à une méthémoglobinémie.
Repères
La douleur est une information sensitive qui résulte de la stimulation de capteurs sensoriels périphériques et est transmise au système nerveux central via les nerfs périphériques. La conduction de l’influx nerveux est liée aux modifications du gradient électrique de part et d’autre de la membrane cellulaire (potentiel d’action), notamment médié par les canaux sodiques. L’anesthésique local interrompt cette conduction. La cocaïne fut le premier anesthésique à être utilisé.
- Tests Covid-19 interdits aux préparateurs : la profession interpelle le ministère
- Tests de dépistage du Covid-19 : les préparateurs ne peuvent plus les réaliser
- [VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »
- Nouvelles missions : quelle place pour les préparateurs ?
- [VIDÉO] Damien Chamballon : « Les préparateurs sont prêts à s’engager dans les nouvelles missions »
- [VIDÉO] Régulation de l’installation des médecins, un poisson d’avril ?
- Méthotrexate : encore trop d’erreurs
- [VIDÉO] Entre le « jaune » des missions et le « bleu » de la rentabilité, le vert de l’officine est en devenir
- Retrait des tests Covid-19 aux préparateurs : le ministère n’était pas au courant !
- Cosmétiques : la DGCCRF muscle ses contrôles