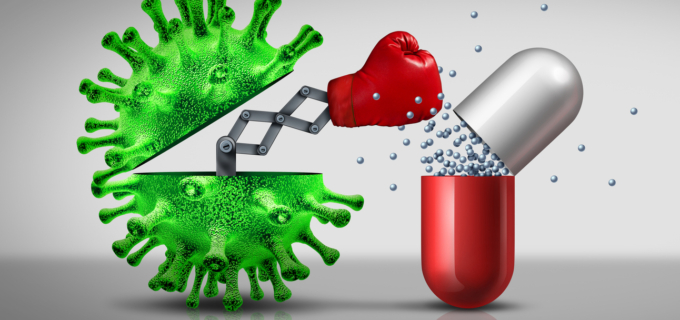- Accueil ›
- Préparateurs ›
- Savoirs ›
- La maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson
Si la maladie reste incurable, les traitements antiparkinsoniens permettent une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Surtout s’ils s’accompagnent d’une rééducation précoce et de règles d’hygiène de vie essentielles.
Définition
La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative du système nerveux central. Elle se caractérise par une dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques dans la zone du cerveau qui contrôle la motricité. La destruction de ces cellules provoque un déficit en dopamine qui est le principal neurotransmetteur régulateur du mouvement. La diminution significative de dopamine provoque un déséquilibre biochimique et s’accompagne d’une hyperactivité d’un autre neuromédiateur : l’acétylcholine. Au début, des mécanismes compensateurs masquent le déficit en dopamine, on estime que les symptômes apparaissent quand 80 % des cellules sont déjà détruites.
Symptômes
Le début de la maladie est souvent discret, quelquefois seules sont perceptibles des douleurs articulaires accompagnées de crampes et d’une fatigue musculaire anormale. En quelques années s’installent, à divers degrés, des troubles moteurs : c’est la « triade parkinsonienne » caractérisée par le tremblement de repos, l’akinésie ou lenteur des mouvements et l’hypertonie ou rigidité musculaire. La maladie évolue vers des troubles de posture, de la marche et une perte de mobilité progressive. À long terme, peuvent se greffer des troubles du psychisme et de l’élocution.
But du traitement
Dans l’état actuel des connaissances, il n’y pas de traitement curatif de la maladie de Parkinson. Les traitements disponibles permettent cependant d’améliorer les symptômes et la qualité de vie des parkinsoniens dont l’espérance de vie est aujourd’hui normale. Il n’existe pas de « traitement standard », il doit être personnalisé en tenant compte de l’âge du patient, de son activité et du stade de la maladie. Le traitement médicamenteux vise essentiellement à compenser le déficit en dopamine au niveau du cerveau et à contrer l’hyperactivité cholinergique. Le problème majeur des médicaments est leur diminution d’efficacité au cours des années. La prise en charge ne se limite pas à la prise de médicaments : rééducation, kinésithérapie et orthophonie en font partie intégrante. Dans certains cas, on peut également recourir à la chirurgie. Aidé de son entourage, le patient doit réorganiser sa vie quotidienne afin de maintenir une activité physique et intellectuelle, d’adapter son alimentation et de préserver son autonomie.
Les médicaments
Les dopaminergiques
Leur rôle est de pallier par différents mécanismes le déficit en dopamine.
• La lévodopa. C’est le traitement de référence. La dopamine ne peut être utilisée comme telle car elle ne passe pas la barrière hématoencéphalique. On utilise la L-dopa, précurseur inactif, qui sera transformée en dopamine dans le cerveau sous l’action d’une enzyme : la dopadécarboxylase. Afin d’éviter la formation de dopamine en périphérie, on associe toujours la L-dopa à un inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique : le bensérazide dans Modopar ou la carbidopa dans Sinemet. Elle agit surtout sur l’akinésie et la rigidité, secondairement sur les tremblements. Plusieurs formes galéniques sont disponibles : les formes standard en comprimés secs ou dispersibles ont une action courte mais rapide, les formes à libération prolongée permettent de réduire la fréquence d’administration et d’éviter les pics plasmatiques responsables des effets secondaires. La L-dopa est prescrite à doses progressives jusqu’à une dose minimale efficace. Après quelques années de traitement, des complications motrices apparaissent : d’une part, une efficacité fluctuante du traitement avec des blocages en fin de dose, c’est ce qu’on appelle communément l’effet « on-off » de la L-dopa. D’autre part, des mouvements anormaux involontaires ou dyskinésies qui apparaissent en milieu ou en fin de dose. Contre-indications : infarctus du myocarde, psychoses, confusions mentales, ulcère en poussée évolutive. Votre conseil : la prise se fait plutôt à jeun ou avec un peu de nourriture. Pour éviter les fluctuations d’activité, il faut respecter précisément les horaires de prise. Les comprimés dispersibles peuvent être dissous dans l’eau et aromatisés avec du sucre ou du jus d’orange. Lors d’une première prise, prévenir que les urines peuvent se colorer en brun-noir. Il ne faut jamais interrompre le traitement brutalement.
La maladie de Parkinson expliquée Les médicaments antiparkinsoniens• Les agonistes dopaminergiques. Ils stimulent directement les récepteurs dopaminergiques à la place de la dopamine. Leur effet est moins puissant que celui de la L-dopa mais leur durée d’action est plus longue et ils présentent moins de risques de complications motrices. On dispose actuellement de deux types de produits : les dérivés de l’ergot de seigle (Parlodel, Bromo-Kin, Dopergine, Arolac, Célance) et les non-ergotés (Apokinon, Trivastal, ReQuip, Mantadix). Longtemps réservés aux stades avancés de la maladie, ils sont maintenant prescrits dès la phase initiale, seuls ou associés à la L-dopa dont ils permettent de diminuer la posologie. La prescription d’un antivomitif en début de traitement est fréquente pour améliorer la tolérance digestive. L’apomorphine est un agoniste très puissant d’action rapide et brève, utilisé en sous-cutané pour « débloquer » en quelques minutes au cours des complications motrices de la L-dopa (blocage, dyskinésies). Le patient peut se l’injecter, à la demande, à l’aide d’un stylo. Contre-indications : les dérivés de l’ergot de seigle sont contre-indiqués en cas de troubles vasculaires périphériques comme l’HTA non contrôlée, le syndrome de Raynaud, l’artériopathie des membres inférieurs. Conseil : la prise doit se faire en début ou milieu de repas pour améliorer la tolérance digestive. L’apomorphine se conserve trente jours à l’abri de la lumière, le stylo doit être soigneusement rebouché après chaque utilisation.
• L’amantadine. Son mode d’action reste discuté. Elle faciliterait la libération de dopamine par les cellules nerveuses. Efficace sur l’akinésie et l’hypertonie, son effet n’est pas ressenti par tous les parkinsoniens et s’épuise généralement en quelques mois.
• Inhibiteur du catabolisme de la dopamine. La dopamine est catabolisée par deux types d’enzymes : les monoamines-oxydases (MAO) et la catéchol-O-méthyltransférase (COMT). L’administration d’inhibiteurs de ces enzymes permet d’augmenter la demi-vie, de prolonger l’action de la dopamine et d’en diminuer les posologies.
– La sélégiline, inhibiteur sélectif de la MAO de type B. Elle agit au niveau du cerveau en bloquant l’action de la monoamine-oxydase et pourrait exercer un effet protecteur des neurones. Indiquée en début de traitement pour retarder la dopathérapie, elle est ensuite prescrite en association.
– Les inhibiteurs de la COMT. Le tolcapone (Tasmar), seul inhibiteur d’action centrale, a été retiré du marché. Reste l’entacapone qui ne passe pas la barrière hématoencéphalique et qui a plutôt une action périphérique. Cette molécule est utilisée en association pour diminuer les troubles moteurs induits par la L-dopa (phénomène « on-off »).
Les anticholinergiques
Ils s’opposent à l’hyperactivité des neurones cholinergiques. Ils sont aujourd’hui moins prescrits car ils sont responsables d’effets secondaires fréquents et sévères, surtout chez les personnes âgées. Ils agissent principalement sur le tremblement. On les réserve en général aux tremblements débutants chez les patients de moins de 65 ans, mais ils peuvent également être associés aux dopaminergiques.
Contre-indications : glaucome, adénome prostatique.
La chirurgie
Son indication est restreinte aux formes graves de la maladie qui résistent aux traitements médicamenteux. Dans huit cas sur dix, elle permet une amélioration de l’état du patient qui se prolonge une dizaine d’années en moyenne. Mais elle présente des risques de complications graves comme des infections ou des hématomes intracérébraux. La neurochirurgie est donc réservée aux patients coopérants, en bon état général, sans troubles cognitifs ou dépressifs. La plus pratiquée actuellement est dite stéréotaxique, c’est-à-dire de stimulation du noyau sous-thalamique par des électrodes branchées par un câble qui court sous la peau jusqu’à une batterie réglable installée au niveau du thorax. Ce stimulateur permet de modifier la puissance de la stimulation selon l’évolution de la maladie.
La rééducation
Elle fait partie intégrante du traitement et fait appel à différents professionnels. Le kinésithérapeute peut aider le parkinsonien par des massages décontracturants et des exercices destinés à améliorer la coordination de la motricité globale, dès le début de la maladie. L’orthophoniste contribue à maintenir une bonne élocution, en particulier quand la voix devient étouffée et monotone. Un ergothérapeute aide au maintien des gestes quotidiens, en particulier l’écriture.
Règles de vie
La mobilisation
• Préserver l’autonomie autant que possible. Chaque geste est un effort pour le malade, il doit lutter contre l’envie de « baisser les bras ». En pratiquant seul les gestes courants comme se laver ou s’habiller mais aussi en gardant une activité physique quotidienne comme la marche, le sport, la gymnastique, il conservera la meilleure aisance motrice possible.
• Habillement. Quand le patient est à un stade évolué de la maladie, on peut lui permettre de prolonger son autonomie par des mesures simples comme des vêtements amples, faciles à enfiler, des velcros, des chaussures sans lacets.
• Mobilier. Le mobilier peut être adapté en évitant tous les obstacles (petits meubles, tapis, fils électriques) qui pourraient provoquer une chute. Penser aussi aux rampes dans les escaliers ou dans la salle de bains ou encore à une potence de lit.
Psychisme
Maintenir une activité intellectuelle journalière est fondamental pour éviter la détérioration des facultés de mémoire et de concentration. On encourage d’ailleurs les patients actifs à poursuivre, si possible, leur activité professionnelle. La tendance dépressive du parkinsonien est bien connue : elle est généralement prise en charge par un traitement antidépresseur classique. L’attitude triste et inerte des patients s’explique cependant en partie par la rigidité faciale qui rend le visage inexpressif et le sourire difficile. Chez le malade parkinsonien âgé, les troubles psychiques ne sont pas rares allant de simples confusions passagères à la démence.
L’alimentation
Elle doit être riche en fibres végétales et accompagnée de boissons abondantes afin de lutter contre une fréquente constipation des malades. Les protéines (viandes, poissons, charcuterie…) réduisent l’absorption de la L-dopa par l’organisme, donc son efficacité. Il vaut mieux les éviter pendant la journée et les réserver au dîner car il y a peu d’efforts moteurs à fournir pendant la nuit. Si le malade se plaint de crampes, conseiller une supplémentation en calcium et magnésium. En cas de troubles de la déglutition, les aliments peuvent être passés au mixeur.
Sommeil
Anxiété et troubles moteurs ne facilitent pas le sommeil. Attention cependant aux anxiolytiques et hypnotiques qui « ralentissent » le patient et l’entretiennent dans sa passivité ! Préférer une bonne hygiène de vie (sport, relaxation) et la phytothérapie.
Rôle de l’entourage
Il est bien sûr primordial pour soutenir le patient mais les proches doivent résister au désir de le « materner » et, au contraire, l’inciter à l’activité. En se rapprochant d’une association, ils seront moins démunis et plus aptes à lutter efficacement aux cotés du malade.
Association France Parkinson, 37 bis, rue Lafontaine, 75016 Paris, tél. : 01 45 20 22 20.
Gros planUn traitement évolutif
Les ordonnances des parkinsoniens évoluent au fil des années. D’une part, parce que les symptômes de la maladie évoluent, d’autre part, parce que les médecins « économisent » les bénéfices de la L-dopa et ne la prescrive pas toujours d’emblée. Même s’il n’y a pas de « recette » thérapeutique, l’évolution est souvent la suivante :
• Abstention thérapeutique tant que la maladie n’a pas de retentissement moteur.
• Si la gène est minime comme un tremblement isolé, les agonistes dopaminergiques, la sélégiline ou les antagonistes cholinergiques sont prescrits seuls.
• Quand le retentissement fonctionnel est plus important, les agonistes dopaminergiques sont poursuivis seuls le plus longtemps possible avant d’être associés à la L-dopa.
• Chez la personne âgée, la L-dopa est souvent prescrite d’emblée.
à savoirDiagnostic différentiel. Les syndromes extrapyramidaux
Les syndromes extrapyramidaux sont des syndromes qui se manifestent par les mêmes symptômes moteurs que la maladie de Parkinson mais qui n’ont ni la même cause, ni la même évolution. Ils sont fréquemment induits par la prise de neuroleptiques purs ou cachés (métoclopramide, antihistaminiques…). Parmi les autres causes, on retrouve les traumatismes crâniens ou les accidents vasculaires répétés, les intoxications au manganèse, plomb, monoxyde de carbone ou mercure, les troubles du métabolisme du fer ou du cuivre. On peut généralement les différencier de la maladie de Parkinson par l’administration de L-dopa qui n’améliore pas les symptômes des syndromes extrapyramidaux.
Qu’est-ce que « la lune de miel » des parkinsoniens ?
c’est la période qui suit l’installation du traitement à la L-dopa et pendant laquelle les symptômes sont nettement améliorés. Elle varie de 2 à 10 ans selon les patients.
Une « la lune de miel » courte est-elle le signe d’une aggravation rapide de la maladie ?
Non, pas nécessairement, elle peut être très courte sans présager d’une détérioration rapide des facultés du patient.
Que faire en cas d’oubli d’une prise de L-dopa ?
Il ne faut surtout pas doubler la prise suivante mais elle peut être un peu avancée.
Quels traitements pour le futur ?
Des greffes de neurones dopaminergiques centraux ont été récemment réalisées chez quelques patients avec des résultats encourageants. On compte aussi sur la thérapie génique.
Qu’est-ce que le freeezing ?
Caractéristique des parkinsoniens, c’est un trouble de l’initiation de la marche qui se traduit par un piétinement au démarrage et qui est responsable de chutes fréquentes.
Le tabac est-il protecteur ?
D’après plusieurs enquêtes épidémiologiques, la nicotine, qui stimule la libération de dopamine, protégerait de la maladie de Parkinson… Mais pas des autres méfaits du tabac !
- Tests Covid-19 interdits aux préparateurs : la profession interpelle le ministère
- Tests de dépistage du Covid-19 : les préparateurs ne peuvent plus les réaliser
- [VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »
- Nouvelles missions : quelle place pour les préparateurs ?
- [VIDÉO] Damien Chamballon : « Les préparateurs sont prêts à s’engager dans les nouvelles missions »
- [VIDÉO] Régulation de l’installation des médecins, un poisson d’avril ?
- Méthotrexate : encore trop d’erreurs
- [VIDÉO] Entre le « jaune » des missions et le « bleu » de la rentabilité, le vert de l’officine est en devenir
- Retrait des tests Covid-19 aux préparateurs : le ministère n’était pas au courant !
- Cosmétiques : la DGCCRF muscle ses contrôles