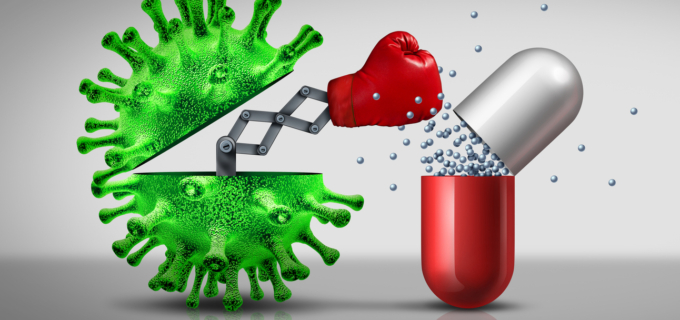- Accueil ›
- Préparateurs ›
- Métier ›
- Vaccination je t’aime moi non plus
Vaccination je t’aime moi non plus
Malgré une opinion majoritairement favorable à la vaccination, une partie des Français exprime des réserves et appelle à une information plus objective. Une carte à jouer pour les professionnels de santé en vue d’une meilleure couverture vaccinale.
Quand les vaccins sont à portée de main, hésiter à les faire me semble surréaliste », s’étonne Alma. Mexicaine, elle a été confrontée l’année dernière à la typhoïde et à la grippe A, pour lesquelles les vaccins étaient indisponibles dans son pays. « Au fond, j’envie ces préoccupations, possibles en France car le système de santé est au top. » Enfants gâtés, les Français savent ce qu’ils doivent à la vaccination, plus de neuf sur dix y sont favorables ou très favorables (1). Pourtant, l’adhésion systématique au geste s’érode, et la couverture vaccinale reste globalement insuffisante (voir p. 17). En cause, la négligence, qui peut expliquer les retards, mais aussi des réserves liées à la peur des complications et ciblées sur certains vaccins (voir sondage ci-contre). Le manque de réponses objectives et la désinformation médiatique nourrissent également les hésitations du patient, à peine levées par les professionnels de santé. Leur formation en vaccinologie est insuffisante. C’est là aussi où le bât blesse.
Des réticences ciblées. Écartons d’emblée l’idée que les opposants purs et durs à la vaccination ont envahi l’Hexagone. Ils sont marginaux. D’après le baromètre santé 2005, seuls 1,5 % des Français seraient opposés à l’ensemble des vaccins. « C’est le même type de noyau dur que dans les autres pays européens, mais plus faible, estime Christine Jestin, médecin de Santé publique, responsable du pôle maladies infectieuses à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), celui qui s’appuie sur des théories philosophicoécologiques, supporter des médecines douces. » La majorité des réticences découle d’une perception personnelle. Chacun « concocte » sa décision en évaluant les risques et leur acceptabilité par rapport aux bénéfices individuels attendus. Une émulsion complexe dans laquelle le vaccin, son efficacité et son innocuité représentent un ingrédient de taille. « Globalement les vaccins anciens, comme le DTP ou le ROR, sont très bien acceptés par rapport à des vaccins plus récents moins connus, pour lesquels on manque de recul », poursuit Christine Jestin. L’estimation de la vulnérabilité est aussi un ingrédient décisif, comme en témoigne la bonne couverture des jeunes enfants par rapport aux adultes. « Les vrais questionnements de vaccination arrivent avec les enfants, témoigne Marine, maman de Lucas, 4 mois, qui suit les recommandations du pédiatre à la lettre. Pour mes propres vaccinations, j’avoue ne pas savoir où j’en suis. » Les circonstances jouent aussi, associées parfois à une forte composante émotionnelle. « Si je n’avais pas été enceinte, je n’aurais pas fait le vaccin contre la grippe A », poursuit Marine. Enfin, la perception de la maladie et de sa gravité pèse lourd dans la décision. D’après l’enquête Nicolle (« Connaissances, attitudes et comportements face au risque infectieux »), de l’Inpes, réalisée en 2006, les maladies infectieuses passent après les cancers et les maladies cardiovasculaires dans les préoccupations. Pour Christine Jestin, codirectrice de l’enquête, c’est très variable selon la maladie. Si les parents ont peur de la méningite, ce n’est plus le cas pour d’autres maladies devenues rares. Beaucoup ignorent la potentielle gravité de la rougeole, par exemple. Paradoxe d’une politique vaccinale victime de son succès, les Français en oublient les bénéfices. « Jusqu’à ce qu’on leur rappelle le nombre de morts évités par an ! » remarque Sophie, préparatrice près de Carcassonne.
Méfiances profondes et mentalité curative. Près de 84 % des sondés par Porphyre pensent que les réserves exprimées sont principalement liées au risque d’effets indésirables et de complications imputés aux vaccins. « Hépatite B et sclérose en plaques, c’est de loin ce qui revient le plus souvent », constate Florence, préparatrice bretonne. La polémique autour de cette vaccination, aiguisée par le tapage médiatique et l’arrêt brutal des vaccinations scolaires en 1998, a sérieusement entamé la confiance à l’égard de la sécurité des vaccins. « Même si, au final, une enquête qualitative menée en 2008 a montré que beaucoup n’avaient pas notion exacte du pourquoi de leurs réticences », remarque Christine Jestin. Sclérose en plaques, myofasciite à macrophages, syndrome de Guillain-Barré, et plus récemment narcolepsie… Les polémiques en bonne place dans les médias ne dépassent pas forcément les frontières. « Hépatite B et sclérose en plaques, ah bon ? s’étonne cette maman québécoise. Chez nous, c’est plutôt mercure et autisme. » Les études d’expertise existantes, même si elles ne prouvent aucun lien de causalité, ne connaissent pas la même ferveur médiatique et n’effacent pas la confusion. Les doutes semblent durablement installés, et 55 % des Français approuvaient l’idée en 2004 qu’il est très angoissant de se faire vacciner avec un nouveau vaccin, même soigneusement testé (2). « Quand tout va bien, tout va bien, ironise Florence. On a du mal avec la prévention, comme pour le diabète ou l’hypertension, on va directement au traitement. » De mentalité plutôt curative, les Français acceptent plus facilement un traitement thérapeutique que prophylactique inoculé dans un corps sain pour un risque jugé lointain. Seuls 16 % reconnaissent les actes de prévention comme importants. Ce taux est le plus faible d’Europe, loin derrière l’Espagne notamment (51 %).
Les dégâts d’une communication défaillante. « Si le public est sceptique, c’est qu’il n’a pas assez d’informations, remarque Florence, et les controverses n’aident pas. » La préparatrice se souvient de la grippe A. Un jour il fallait deux doses, le lendemain une seule, difficile de savoir sur quel pied danser au comptoir. Faute de données objectives, la confiance s’effrite envers la politique de santé de l’État. « L’hépatite B, Tchernobyl, le sang contaminé… on préfère dire qu’il n’y a aucun danger plutôt que de dire qu’on ne sait pas. À force on ne croit plus », soupire une maman, dépitée. Une communication étatique qui s’appuie par ailleurs trop souvent sur la peur. Pour l’hépatite B, par exemple, on a longtemps exagéré les données médicales et présenté la salive comme un mode de contamination courant. « C’est une bêtise et une incohérence que de faire peur aux gens via les médias, ça ne marche pas, s’insurge Laurent, préparateur depuis vingt ans, pour qui l’information objective, mal relayée, ne fait pas le poids devant les polémiques largement médiatisées. C’est même parfois une désinformation à 200 %. Pourquoi des messages à deux balles ? Soyons explicites ! » Les campagnes de sensibilisation du grand public sont rares. Les taux de réduction de l’incidence des maladies sont difficilement accessibles à M. Tout-le-Monde, qui s’en tient au sensationnalisme des médias. « Les patients lisent des choses sur Internet, ils ont l’impression d’en savoir plus que nous, mais ça entretient surtout leurs peurs irrationnelles », s’agace Virginie, pharmacienne à Paris. Les anti-vaccinations ont envahi la toile sans aucun contrepoids. « Un site grand public,vaccination.fr, est en projet, mais il y a un début de réponse avec le site de la semaine de la vaccination, www.semaine-vaccination.fr », précise Christine Jestin. Ces moyens de communication restent insuffisants pour des Français qui réclament plus de transparence afin de se sentir responsabilisés. Les professionnels de santé ne semblent guère plus touchés par les messages institutionnels. D’après notre sondage, les sources d’information à l’officine sont majoritairement la presse professionnelle et les labos, loin devant les institutions. « Même les pros doivent chercher l’info », s’étonne Laurent.
Le poids du corps médical. La méfiance envers la vaccination n’épargne pas le corps médical. Selon le baromètre santé 2003, les généralistes et les pharmaciens sont très majoritairement favorables à la vaccination (respectivement 97,1 % et 96,8 %), et le sont toujours d’après le baromètre 2009. Pour certains, les certitudes sur la balance bénéfice/risque se sont altérées. « De même que pour le traitement hormonal substitutif, les médecins disent avoir été traumatisés par l’histoire de l’hépatite B », explique Christine Jestin. Une étude de 2005 auprès de 400 généralistes et pédiatres montrait que 31 % d’entre eux avaient des craintes par rapport à la sécurité des vaccins et que 58 % se questionnaient sur l’opportunité de certains vaccins infantiles. La complexification du calendrier vaccinal pose par ailleurs des problèmes pratiques. Les injections répétées chez le jeune enfant, l’évolution rapide des recommandations, le nombre important de spécialités vaccinales sèment la confusion. Devant les réticences et leurs propres doutes, certains préfèrent ne pas insister. Le statut vaccinal des professionnels de santé reste d’ailleurs insuffisant. Pour la grippe, alors que l’objectif national de couverture est fixé à 75 %, 74,3 % des généralistes se sont fait vacciner en 2005, devant 43 % des pharmaciens ou 31 % des infirmiers libéraux. Or, l’influence du corps médical est souvent décisive pour le public. On estime que 61 % de personnes suivent à la lettre les recommandations vaccinales de leur médecin, promoteur de la vaccination dans un cas sur trois, voire plus pour les enfants. « C’est flagrant dans une pharmacie de village, explique Laurent. Pour la grippe A, on nous demandait d’abord si nous-mêmes voulions nous vacciner. » Par ailleurs, un clivage se creuse entre les généralistes, dont 80 % n’appliquent pas les recommandations à la lettre, et les pédiatres, plus motivés à vacciner. « Pour le vaccin contre l’hépatite B de mon bébé, mon généraliste me disait « non » de façon véhémente. Pour mon pédiatre, c’était oui, sans hésiter », se rappelle Anne, qui avoue avoir eu bien du mal à faire la part des choses. La formation, plus poussée pour les pédiatres que pour les généralistes explique en grande partie ce clivage. Selon Daniel Floret, président du Comité technique des vaccinations (voir entretien), la formation continue des professionnels est le préambule incontournable à l’information objective du public. Virginie, pharmacienne parisienne, avoue ne pas se sentir au top. « Au comptoir, il m’est arrivé de me sentir impuissante face à des réticences, par manque d’argument, et au final j’ai renoncé. » Un sentiment partagé par 66 % de nos officinaux sondés, qui s’impliqueraient davantage dans le suivi vaccinal s’ils étaient formés. « La difficulté est d’apporter des réponses sans engager nos convictions personnelles, de rester professionnels pour ne pas influencer », souligne Laurent. Une information objective et actualisée pour devenir responsable de sa propre santé, voilà le terrain sur lequel vous attendent les patients en quête de démocratie sanitaire.
(1) Baromètre Santé 2005 de l’INPES.
(2) D’après le guide vaccination 2008, INPES.
(3) Vaccins : la perception européenne homogène et positive d’un secteur, résultats de l’enquête, 2005, EVM, Psyma International Medical, 2004.
Des succès indéniables
À part l’eau potable, aucun progrès de la médecine (y compris les antibiotiques) n’a autant réduit la mortalité dans le monde entier.
La vaccination :
• évite annuellement 2,5 millions de décès par diphtérie, tétanos, coqueluche et rougeole ;
• a permis l’éradication de la poliomyélite aux États-Unis, et une réduction de plus de 99 % des cas en Europe ;
• a permis, accompagnée des mesures d’hygiène adéquates, d’éradiquer la variole dans le monde entier.
72 spécialités vaccinales disponibles, simples ou combinées
• 22 nouveaux vaccins depuis la Seconde Guerre mondiale.
• 24 indications vaccinales actuelles :
virales : poliomyélite, grippes, rage, hépatites A et B, encéphalites à tiques et japonaise, infections à papillomavirus humains, fièvre jaune, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, zona, infections à rotavirus ;
bactériennes : diphtérie, tétanos, coqueluche, leptospirose, tuberculose, infections aux méningocoques (sérogroupes A et C ou A, C, Y, W135 ou C), infections à pneumocoques (7 ou 13 ou 23 valences), fièvre typhoïde, infections à Haemophillus influenzae type b.
Des vaccinations obligatoires
Obligatoires en population générale :
• diphtérie, tétanos et poliomyélite pour tous (primovaccination et rappel à l’âge de 16-18 mois pour les trois maladies et rappels pour la poliomyélite jusqu’à l’âge de 13 ans);
• fièvre jaune pour les résidents et voyageurs en Guyane.
Recommandées en population générale :
• rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, hépatite B, infections invasives à Haemophilus influenzae type b (Hib), infections invasives à pneumocoques.
Les dérogations à la vaccination
En cas de contre-indications définitives et médicalement documentées à titre de : antécédent de troubles neurologiques ou réaction allergique grave de type anaphylactique à certains composants des vaccins (gélatine, allergène lui-même, alumine, traces d’antibiotiques…) ou immunodéficience pour les vaccins vivants.
Elles donnent lieu à un certificat médical.
Qui fixe la politique vaccinale ?
En France, c’est le ministre de la Santé qui fixe les conditions d’immunisation souhaitables, énonce les recommandations adéquates et rend public le calendrier vaccinal après réévaluation annuelle et avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), et plus particulièrement de son groupe de travail permanent du Comité technique des vaccinations (CTV).
Qui vaccine ?
La vaccination est un acte médical. Il peut être effectué par :
• un médecin (généralistes, pédiatres, médecins du travail…) ;
• une sage-femme pour certains vaccins (pour les femmes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, grippe, rubéole ; pour les nouveau-nés : BCG et hépatite B en association avec les immunoglobulines spécifiques anti-HBs chez ceux nés de mère porteuse de l’antigène anti-HBs) ;
• un infirmier diplômé d’État pour le vaccin antigrippal sur prescription médicale.
Quelles sanctions sont prévues ?
Sauf contre-indications médicales reconnues, le non-respect de l’obligation vaccinale est qualifié de délit et expose à un refus d’inscription en collectivité, voire à une amende de 3 750 euros et six mois d’emprisonnement (ces deux dernières sanctions restant théoriques).
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, article 37).
Surveiller les effets indésirables
Tout professionnel de santé ayant eu connaissance d’un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d’être dû à un vaccin doit le déclarer aussitôt au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont il dépend*. En pratique :
• à l’aide d’une fiche standard CERFA obtenue par simple demande auprès de tous les CRPV ou
• sur le site de l’Afssaps (www.afssaps.sante.fr, rubrique « infos pratiques »).
* Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 relatif à la pharmacovigilance.
Des taux de vaccination insuffisants et inégaux
Pour contrôler et éliminer une maladie, l’objectif est d’obtenir et de maintenir la couverture vaccinale à un taux de 95 % au moins aux âges appropriés.
En France, la couverture est bonne pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et les infections à Hib chez les enfants. Elle est insuffisante pour les autres maladies, de façon marquée pour l’hépatite B et chez les adultes en général.
Se former
• DIU de vaccinologie (Paris-V et VI et l’université Claude-Bernard – Lyon-I)
> Programme : bases immunologiques et épidémiologiques de la vaccination, vaccinations générales.
Enseignements en trois séminaires de 3 jours répartis sur l’année.
> Public : médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé sur demande et après acceptation du dossier par le conseil pédagogique.
Renseignements administratifs : 04 78 77 75 76.
• IFMO-Qualipharm, Formation vaccination.
> Programme : enjeux de la vaccination préventive, aspects pratiques, calendrier vaccinal, vaccins du voyageur, réponses aux questions courantes.
Une journée de sept heures.
> Public : titulaires, adjoints et préparateurs.
Renseignements : 03 88 55 00 55
Prise en charge FIF-PL et OPCA-PL.
S’informer
• Le calendrier vaccinal
Actualisé chaque année, il est publié au Bulletin officiel du ministère la Santé et repris dans le BEH. Téléchargeable sur le site de l’Institut de veille sanitaire. (http://invs.sante.fr).
• La ligne directe Infovac
Information sur les vaccinations par des experts. Réservée aux professions de santé (20 €/an).
• Le guide vaccination
Édité par l’Inpes, la dernière version date de 2008, ce guide pratique est destiné aux soignants (différents vaccins, réticences, conduite à tenir…). Un livret « Questions de patients » est destiné au grand public.
Téléchargeables sur le site www.inpes.sante.fr, dossier « Vaccinations, ouvrons le dialogue ».
- Tests Covid-19 interdits aux préparateurs : la profession interpelle le ministère
- Tests de dépistage du Covid-19 : les préparateurs ne peuvent plus les réaliser
- [VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »
- Nouvelles missions : quelle place pour les préparateurs ?
- [VIDÉO] Damien Chamballon : « Les préparateurs sont prêts à s’engager dans les nouvelles missions »
- Rapport des industriels du médicament : les 5 chiffres à retenir pour l’officine
- Insécurité : 9 officines sur 10 victimes d’infractions
- Les patients sous Colchimax sont-ils éligibles aux entretiens courts « opioïdes » en officine ?
- Cut by Fred arrive en pharmacie avec des soins capillaires naturels
- La question des remises sur les génériques toujours d’actualité