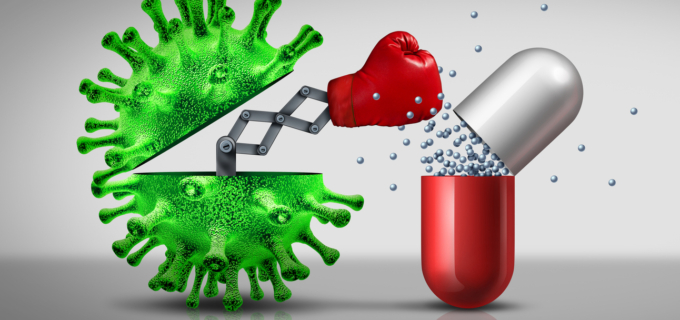- Accueil ›
- Conseils ›
- Pathologies ›
- L’intoxication au paracétamol
L’intoxication au paracétamol
Sûr et efficace aux doses recommandées, le paracétamol expose à de graves complications hépatiques en cas de surdosage. Le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge, de la dose et des facteurs de vulnérabilité.
Comment agit le paracétamol ?
• Indication. Le paracétamol, contraction de para-acétylaminophénol, est un antipyrétique antalgique de palier I selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est recommandé en première intention dans les douleurs nociceptives aiguës légères à modérées.
• Mode d’action. Il reste mal connu mais il serait à la fois périphérique et central. Il agirait notamment sur les centres thermorégulateurs hypothalamiques, d’où son action antipyrétique, et sur l’inhibition de la synthèse des prostaglandines, d’où son action antalgique. Selon de récentes hypothèses, le paracétamol ne serait qu’une « prodrogue », le principe actif étant un produit de sa métabolisation hépatique en p-aminophénol. Ce dernier, en se combinant à l’acide arachidonique au niveau cérébral, formerait un acide gras inhibant les canaux calciques des neurones impliqués dans la modulation de la douleur.(4)
• Métabolisme.(5) Après absorption intestinale, le pic plasmatique est atteint entre 30 minutes et 2 heures.
→ Le paracétamol est ensuite métabolisé dans le foie à 90%, via deux voies majoritaires, la glucuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Les métabolites sont excrétés dans les urines.
→ Une petite fraction, inférieure à 10%, suit une autre voie. Elle est oxydée au niveau hépatique, via les enzymes du cytochrome P450, en autres métabolites, principalement le N-acétylp-benzoquinone imine (NAPQI), hépatotoxique. À dose thérapeutique, le NAPQI est rapidement neutralisé par conjugaison au glutathion – dont un stock est présent dans le foie – et éliminé dans les urines.
Comment s’intoxiquer ?
• Circonstances. L’ingestion de surdoses de paracétamol est involontaire par erreur de dosage, d’identification…, ou volontaire. Il est le premier médicament impliqué dans les intoxications médicamenteuses volontaires en France.(3)
• Intoxication aiguë ou chronique.
→ Elle est dite aiguë pour une prise unique ou des prises répétées sur un laps de temps court, moins de huit heures.
→ Elle est chronique après des doses répétées sur un délai supérieur. Elle est fréquemment retrouvée lors d’épisodes douloureux aigus : migraine, rage dentaire… Exemple : une personne qui aurait pris du paracétamol sur trois jours à hautes doses pour un mal de dents.
• Mécanisme. Le principal risque de surdosage est une hépatotoxicité par saturation des voies de métabolisation. Les voies de glucuro- et sulfoconjugaison étant saturées, la fraction de paracétamol prise en charge par le cytochrome P 450 augmente, tout comme la production du métabolite hépatotoxique NAPQI. Le stock de glutathion, limité, est rapidement dépassé et le NAPQI ne peut être neutralisé. Il se fixe alors et s’accumule dans les cellules hépatiques, où il induit un stress oxydatif responsable d’une cytolyse dose-dépendante. À savoir : le risque chez l’enfant jusqu’à 5 ans est plus faible du fait de la prépondérance de la voie de sulfoconjugaison.
• À quelle dose ? Le risque d’atteinte hépatique existe à partir d’une dose supposée ingérée (DSI). 125 mg/kg (environ 7,5 g) chez un adulte de 60 kg, et une DSI. 200 mg/kg (6,7 g) chez l’enfant. Cette dose peut être inférieure selon les facteurs de vulnérabilité (voir ci-après). C’est pourquoi tout surdosage, documenté ou probable, impose d’appeler un centre antipoison ou d’orienter immédiatement le patient vers une consultation médicale.
Quels facteurs de vulnérabilité ?
Certains facteurs influencent la dose potentiellement toxique et la sévérité de l’atteinte.
• Les facteurs qui ont une répercussion sur le métabolisme du paracétamol. Il s’agit de situations qui peuvent :
→ réduire les stocks de glutathion dans le foie, avec maladie hépatique chronique, malnutrition, jeûne prolongé, et/ou diminuer le nombre d’hépatocytes comme l’alcoolisme, une maladie hépatique ;
→ augmenter l’activité du cytochrome P450 : alcoolisme chronique, traitements inducteurs du CYT P450, tels la rifampicine, le phénobarbital, la carbamazépine…
• D’autres situations favorisent l’intoxication par divers mécanismes : traitement prolongé par fibrates, notamment chez les femmes, ou AINS, stéatose hépatique, notamment en cas d’obésité.
• Des facteurs génétiques ou liés au microbiote intestinal sont avancés. En cas d’hépatopathie chronique sévère, une toxicité hépatique peut être observée lors de la prise de paracétamol à des doses thérapeutiques, d’où sa contre-indication dans ce cas.
Quels sont les symptômes ?
La plupart des intoxications au paracétamol sont d’abord asymptomatiques durant 24 à 48 heures, ce qui ne présage en rien de leur sévérité, d’où le nom de « tueur silencieux ». Typiquement, quatre stades sont décrits, variables selon le degré de l’atteinte.
• Stade 1 ou pré-lésionnel, de 30 minutes à 24 heures, pas ou peu symptomatique, avec possible sensation de malaise général, nausées, diarrhée, perte d’appétit.
• Stade 2 ou hépatite aiguë toxique, de 8 à 72 heures, avec hausse des enzymes hépatiques ASAT et ALAT (voir info+ à droite) et baisse du temps de prothrombine (TP), examen biologique qui évalue la coagulation sanguine. Le signe clinique le plus fréquent est une douleur au niveau de l’hypochondre droit.
• Stade 3 ou hépatite aiguë paroxystique, du 3e au 5e jour. Les transaminases sont très élevées, le TP continue de baisser. La biologie montre une bilirubinémie élevée, une hypoglycémie et une acidose lactique. Selon sa gravité, l’insuffisance hépatocellulaire peut entraîner une encéphalopathie hépatique jusqu’au coma, ou une hépatite fulminante pouvant nécessiter une transplantation. Parfois, une atteinte multiviscérale est concomitante, avec insuffisance rénale, péricardite, pancréatite, oedème cérébral… Ces atteintes sont possiblement létales. Les patients peuvent présenter des nausées, des vomissements, un ictère, des saignements, une altération de la conscience, etc.
• Stade 4 ou récupération, après cinq jours et jusqu’à deux semaines, avec résolution clinique et biochimique de l’hépatotoxicité. Exceptionnellement, l’intoxication massive peut donner d’emblée des troubles de la conscience et une acidose lactique secondaire à une toxicité mitochondriale indépendante de l’atteinte hépatique.
Quelle prise en charge ?
La prise en charge de l’intoxication aiguë se fait en milieu hospitalier, avec une évaluation du risque hépatotoxique, puis un traitement.
• Recueil des données. L’interrogatoire oriente le risque par la dose supposée ingérée (DSI) et l’heure d’ingestion. Il est complété par le dosage du paracétamol sanguin, les transaminases hépatiques, le temps de prothrombine, voire la créatininémie.
• Détermination du risque. Lors d’une intoxication aiguë, les médecins utilisent le nomogramme de Rumack et Matthew, élaboré à partir d’observations cliniques. Il détermine des seuils d’hépatotoxicité possibles, probables ou à haut risque en fonction de la paracétamolémie. Le graphique définit une ligne seuil de traitement, à partir de 150 mg/ml à H4, selon le nomogramme utilisé en France (voir encadré page suivante). À savoir : il s’utilise pour une prise unique et un délai d’ingestion connus, et une paracétamolémie mesurée au-delà de H4. Pour une intoxication chronique, même si la dose totale ingérée est identique à une dose unique, l’ingestion répétée expose à un risque hépatotoxique supérieur. Sa détermination est plus complexe, guidée par la dose totale ingérée, la durée, les résultats de biologie et les signes cliniques.
• Traitements.
→ Décontamination digestive. Elle peut être mise en place dans les deux heures suivant l’intoxication car le paracétamol se trouve encore dans le tube digestif. Elle fait appel à une dose unique orale de charbon actif, à raison de 1 g/kg, maxi 50 g. À savoir : le lavage gastrique, les vomissements provoqués ne sont pas indiqués.
→ Antidote. Le produit utilisé est la N-acétylcystéine (NAC), un précurseur du glutathion, qui permet d’en régénérer les stocks hépatiques. Elle exerce en outre une action anti-inflammatoire et anti-oxydante, ainsi qu’une vasodilatation, qui améliore l’oxygénation tissulaire et la fonction hépatique. Son effet est maximal si elle est administrée dans les huit à dix heures suivant l’ingestion.
Quand l’utiliser ? En cas d’intoxication aiguë, lorsque que l’hépatotoxicité est probable et/ou confirmée par une paracétamolémie.(6) Cet antidote est aussi utilisé de façon plus systématique en cas de données inconnues (dose, horaire…), de consultation tardive, de signes d’hépatite cytolytique, y compris fulminante, en présence de facteurs de vulnérabilité, même à dose inférieure à 125 mg/kg, en cas d’ingestion chronique de doses élevées… Le NAC peut parfois éviter une transplantation hépatique.
Comment ? Le protocole recommandé en France (6 et 7) est identique chez l’adulte et l’enfant. Il fait appel à Hidonac 5 g/25 ml, solution pour perfusion, à raison de 150 mg/kg en une heure (dose de charge), suivis de 50 mg/kg en quatre heures, puis de 100 mg/kg sur seize heures. Fluimucil, par voie orale et hors AMM, est plus rarement employé en France. En l’absence de vomissements et de recours à du charbon activé, Fluimicil s’utilise à raison de 140 mg/kg, puis 70 mg/kg par quatre heures durant 72 heures. En cas d’hépatite cytolytique ou de délai depuis l’ingestion supérieur à 24 heures, le traitement peut être prolongé, à raison de 300 mg/kg par 24 heures, jusqu’à guérison.
Quels effets indésirables ? Un rash cutané, un prurit, de l’urticaire, voire un bronchospasme, sont possibles en cas d’administration rapide de la dose de charge en intraveineuse. Des nausées et des vomissements, voire de la fièvre, peuvent survenir. Les symptômes régressent avec un traitement symptomatique et l’arrêt transitoire ou le ralentissement de la perfusion.
Quelle prévention à l’officine ?
Au comptoir, il est primordial de rappeler le bon usage du paracétamol.
• Contre-indications : insuffisance hépatocellulaire sévère, allergie.
• Posologie. La rappeler systématiquement, surtout en cas de douleur dentaire ou de céphalées rebelles. Prendre la dose la plus faible, le moins longtemps possible. En automédication, c’est trois jours maximum en cas de fièvre, et cinq jours en cas de douleurs. Respecter la dose maximale quotidienne et les délais entre deux administrations.
→ Adulte, poids > 50 kg : 500 mg, voire 1 g, par prise maximum, 3 g par jour maximum en automédication et six heures entre les prises et minimum quatre heures.
→ Si insuf fisance rénale : 3 g par jour maximum, et huit heures entre les prises.
→ Si poids < 50 kg, insuffisance hépatocellulaire légère à modérée, alcoolisme, déshydratation, jeûne, > 75 ans ou 65 ans polypathologique, VIH, hépatite virale chronique : pas plus de 60 mg/kg par jour, sans dépasser 3 g par jour.
→ Enfants. Dose quotidienne de 60 mg/kg par jour à répartir en quatre ou six prises, soit environ 15 mg/kg toutes les six heures ou 10 mg/kg toutes les quatre heures.
• Pas de doublon. Vérifier l’absence de paracétamol dans d’autres médicaments pris en même temps.
• Pas d’accès libre pour les médicaments avec paracétamol.
(1) Paracétamol et risque pour le foie : un message d’alerte ajouté sur les boîtes de médicament , Communiqué ANSM, 9 juillet 2019.
(2) Observatoire multisources des intoxications aiguës en Île-de-France : une étude exploratoire , BEH n° 32-33, pp.579-585, 2015.
(3) Le paracétamol : connaissance, usage et risque de surdosage en patientèle urbaine de médecine générale – Étude prospective descriptive transversale , Cipolat L. et al., Thérapie, 2017.
(4) Le paracétamol emprunte les canaux calciques , Inserm, 11 février 2014.
(5) Intoxication par le paracétamol : quoi de neuf ?, B.Mégarbane, Méd. Intensive Réa n° 26, pp.383-395, 2017.
(6) Intoxications graves par médicaments et substances illicites en réanimation, Mégarbane B., Donetti L., Blanc T., Chéron G., Jacobs F., groupe d’experts de la SRLF, Réanimation n° 15, pp.332-342, 2006.
(7) Intoxication grave par médicaments et/ou substances illicites admise en réanimation : spécificités pédiatriques , Brissaud O., Chevret L., Claudet I., Réanimation n° 15, pp.405-411, 2006.
Avec l’aimable relecture du Dr Corinne Schmitt, pharmacien, Centre antipoison et de toxicovigilance, Hôpitaux Sud, Marseille
Info +
→ Le surdosage en paracétamol
– 1re cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse.(1)
– 2e médicament à l’origine des appels au centre antipoison de Paris, après le bromazépam.(2)
Une étude auprès d’une patientèle majeure en médecine générale révèle que, sur 819 patients (3) :
– 47,9 % consomment du paracétamol plus d’une fois par mois ;
– 20,3 % sont à risque de surdosage potentiel, notamment les plus de 55 ans, les ouvriers et les inactifs ;
– moins de 13 % connaissaient son risque hépatique ;
– 37 % n’associaient pas son surdosage à des conséquences graves.
Info +
→ L’alanine aminotransférase (ALAT) et l’aspartate aminotransférase (ASAT), appelées transaminases, sont deux enzymes présentes dans de nombreux organes, dont le foie, le coeur, le rein, les muscles… Elles reflètent l’activité et la destruction des cellules de ces organes. L’augmentation de leur taux dans le sang témoigne d’une lésion cellulaire, le plus souvent dans le foie.
- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?
- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?
- [VIDÉO] Accompagner le patient parkinsonien à l’officine
- Régimes végétariens : quels effets sur la santé ?
- L’exercice physique est-il recommandé en cas de gonarthrose ?
- Biosimilaires : vers un taux de remise à 30 % ?
- [VIDÉO] Régulation de l’installation des médecins, un poisson d’avril ?
- Méthotrexate : encore trop d’erreurs
- [VIDÉO] Entre le « jaune » des missions et le « bleu » de la rentabilité, le vert de l’officine est en devenir
- Retrait des tests Covid-19 aux préparateurs : le ministère n’était pas au courant !