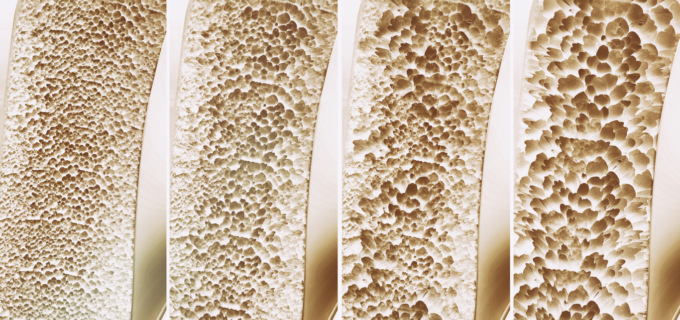- Accueil ›
- Conseils ›
- Pathologies ›
- Après-cancer du sein : comment renforcer l’adhésion aux traitements

© Getty Images
Après-cancer du sein : comment renforcer l’adhésion aux traitements
Les progrès thérapeutiques ont permis de réduire le risque de récidive locorégionale ou à distance des cancers du sein non métastatiques. Le soutien apporté aux femmes postcancer peut faire la différence quant à leur adhésion aux traitements de fond ou au rythme de surveillance.
Parler « récidive », c’est parler « classification » car, grâce à une meilleure compréhension de sa génomique, l’hétérogénéité du cancer du sein est désormais bien établie, éclatée entre trois grands sous-types moléculaires, chacun étant associé à des spécificités pronostiques et thérapeutiques.
Le premier d’entre eux, et aussi le plus fréquent, est le cancer luminal, caractérisé par l’expression du récepteur œstrogène (RE+) et de gènes associés. « C’est celui pour lequel le pronostic est le plus difficile à décrire, car il est très hétérogène selon la nature des autres caractéristiques génomiques », rapporte Paul Cottu, chef de département adjoint en oncologie médicale à l’Institut Curie (Paris). Pour autant, tous les cancers luminaux sont concernés par une même modalité thérapeutique : l’hormonothérapie, prescrite a minima pour 5 ans, parfois 7, voire 10 ans en cas de haut risque de récidive. Comme tout traitement chronique, la question de l’observance se pose. « Les pharmaciens ont donc un rôle très important à jouer pour convaincre les femmes d’y adhérer, a fortiori lorsqu’elles souffrent d’effets secondaires, qui sont fréquents et parfois très pénibles à supporter » : douleurs musculosquelettiques, fatigue, nausées, troubles du sommeil, bouffées vasomotrices, troubles de la libido… « Il faut donc insister sur le bénéfice pronostique du traitement, parfois supérieur à celui qu’apporte la chimiothérapie et leur rappeler que l’hormonothérapie réduit le risque de récidive, même après la fin du traitement, alors qu’un arrêt précoce les expose davantage à la rechute. »
La conviction des professionnels de santé a aussi été rapportée comme un élément différenciant pour la motivation des patientes en matière d’observance, et l’écoute est déterminante. « Il faut être très attentif aux difficultés des patientes face au traitement et repérer tout signe de découragement », poursuit Paul Cottu. A la moindre plainte mettant en péril leur adhésion, une orientation vers l’oncologue est précieuse car il est possible d’adapter le traitement ou d’envisager des approches non médicamenteuses (psychosociales, nouvelles habitudes hygiénodiététiques, etc.) afin d’améliorer la tolérance. Cette question est encore plus déterminante si d’autres traitements sont associés. C’est le cas, d’une part, pour les femmes les plus jeunes chez lesquelles une combinaison d’hormonothérapie (orale plus agoniste injectable de l’hormone de libération de la lutéinostimuline, ou LHRH) est souvent préconisée pour améliorer la survie sans récidive offerte par la monothérapie et, d’autre part, chez celles sans atteinte ganglionnaire et qui sont les plus exposées au risque de récidive : chez elles, l’abémaciclib inhibiteur de CDK 4/6 (Verzenios) est recommandé en association depuis quelques mois, mais il majore les risques d’inobservance. « Il faut aussi leur parler des applications mobiles qui existent et qui favorisent l’adhésion », complète Suzette Delaloge, oncologue médicale à l’Institut Gustave-Roussy (Villejuif, Val-de-Marne).
Parallèlement, les tumeurs HER2+ et les cancers triple négatifs représentent chacun 10 à 15 % des cas. Eux aussi ont vu leur pronostic s’améliorer. Pour les premières, la séquence de traitement la plus efficace repose aujourd’hui sur une chimiothérapie préopératoire et un traitement adjuvant par trastuzumab ou par anticorps conjugué. Cela offre une meilleure probabilité de bénéficier d’une chirurgie conservatrice du sein ; le pronostic sans récidive après chirurgie est d’environ 95 % à cinq ans. Les personnes atteintes de cancers triple négatifs, au pronostic historiquement plus sombre, ont, quant à elles, bénéficié de l’essor de l’immunothérapie : le pembrolizumab a amélioré la survie des patientes répondant au traitement de chimiothérapie néoadjuvant (préopératoire). Dans ce cas, leur pronostic rejoint celui des cancers HER2+. « Au-delà de cinq ans, dans les deux situations, le risque de récidive locorégionale ou métastatique existe, mais de façon mineure », se félicite Paul Cottu.
Un plan personnalisé pour les patients
Quelle que soit la nature de la tumeur initiale, la fin du traitement (ou le passage à l’hormonothérapie) est un moment particulier dans la vie des patientes. D’un parcours balisé par des rendez-vous réguliers, elles passent à une période où l’univers hospitalier et les consultations s’éloignent. Cette phase ne s’improvise pas. « Les praticiens préparent les femmes petit à petit, dans le cadre du plan de traitement au cours duquel la décision médicale est partagée, raconte Suzette Delaloge. Beaucoup de centres comme le nôtre proposent des consultations de transition et des journées pour les sensibiliser aux risques de rechute et de récidive, à la surveillance et aux moyens de conduire cette phase en abordant les questions médicales mais aussi sociales, psychosociales et financières. »
Dès le début de l’après-cancer, l’idéal est de demander à la patiente reçue à l’officine de pouvoir consulter le plan personnalisé d’après-cancer (PPAC) qui lui est normalement remis à la fin des traitements. Il englobe les modalités et le calendrier des consultations médicales – schématiquement tous les trois ou quatre mois –, celui des examens d’imagerie – généralement une mammographie annuelle –, les traitements à maintenir, les effets secondaires prévisibles sur les cinq années à venir. Il livre aussi des données liées à la qualité de vie, à l’accès aux soins de support, et au volet social et administratif.
La connaissance des molécules délivrées à l’officine, de leur maniabilité et de leurs effets indésirables* facilite la discussion et peut renforcer la capacité à convaincre et à motiver l’adhésion. Dans le cadre du cancer du sein, outre les différentes molécules d’hormonothérapie, sont délivrés l’abémaciclib et l’olaparib (Lynparza), anti-PARP préconisé seul ou en association dans les formes avancées ou métastatiques HER2- associées à une mutation BRCA1/2.
Des conseils efficaces
« La pratique d’une activité physique adaptée (APA), favorisée par sa prescription, est sans doute le conseil le plus efficace que l’on puisse apporter aux femmes pendant cette période », reconnaît Paul Cottu. Elle a été décrite comme pertinente pour réduire le risque de récidive et diminuerait la mortalité globale, par rapport aux femmes qui restent sédentaires. « Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque de cancer du sein et d’un moins bon pronostic, mais le bénéfice d’une perte de poids après la maladie n’est pas démontré », rapporte Suzette Delaloge. Plutôt que de complexer les femmes ayant un indice de masse corporelle (IMC) élevé, le message doit plus volontiers porter sur la non-prise de poids ou l’instauration d’une activité physique. Les conseils nutritionnels habituels conformes au programme national nutrition santé (PNNS), avec une consommation d’alcool et de tabac limitée sont légitimes.
En revanche, attention à l’automédication, et aux solutions alternatives comme la phytothérapie. Il faut inviter les femmes à la prudence et leur enjoindre de questionner systématiquement un professionnel – pharmacien ou médecin – avant d’envisager un tel recours. « Après un cancer du sein, elles sont parfois avides d’un meilleur contrôle de leur santé », remarque la spécialiste, mais le choix doit être circonstancié : les apports en vitamine D semblent favorables aux femmes après un cancer du sein, mais ceux en vitamines C ou E pourraient avoir des effets contraires, tout comme les apports en fer et en acide folique. La consommation alimentaire ponctuelle de soja, elle, ne poserait pas de problème. In fine, « c’est l’alimentation diversifiée et équilibrée qui doit être promue car elle est la plus à même de garantir des apports, sans carence ni surconsommation, de ces différents composants, au-delà de ses bienfaits sur la santé en général », conclut-elle.
* Les sites des observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques (Omédit) Bretagne, Normandie et Pays de la Loire proposent des fiches patients et professionnelles synthétisant les indications, posologies, effets indésirables et interactions médicamenteuses pour chaque anticancéreux oral disponible en France.
- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?
- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?
- [VIDÉO] Accompagner le patient parkinsonien à l’officine
- Régimes végétariens : quels effets sur la santé ?
- L’exercice physique est-il recommandé en cas de gonarthrose ?
- Nouvelles missions : l’offre et la demande sont au rendez-vous
- Rapport de l’Igas : le DPC est (sans doute) mort, vive la certification !
- Biosimilaires : vers un taux de remise à 30 % ?
- Aggravation des tensions sur Pegasys : nouvelles règles de dispensation mises en place
- [VIDÉO] Régulation de l’installation des médecins, un poisson d’avril ?