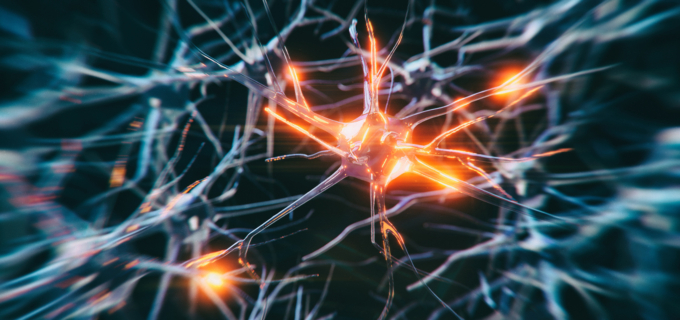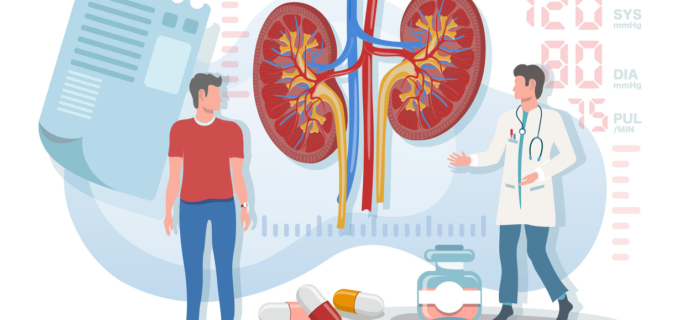- Accueil ›
- Conseils ›
- Maux du quotidien ›
- Les antivitamine K
Les antivitamine K
En France, environ 800 000 patients sont traités par antivitamine K (AVK) et près de 6 000 décès annuels leur sont imputés. Une meilleure maîtrise de leur pharmacodynamie et de leur pharmacocinétique permet de mieux prévenir l’iatrogénie.
Mécanisme d’action
Diminution de la synthèse des facteurs de la coagulation
→ Les AVK inhibent la synthèse hépatique vitamine K- dépendante des facteurs de coagulation II, VII, IX et X. Il en résulte une inhibition de la formation de fibrine.
→ N’ayant pas d’effet sur les facteurs de coagulation déjà synthétisés et présents dans le sang, ils agissent après un délai d’action de 2 à 3 jours et leur pleine efficacité s’observe en 5 jours environ. Leur effet persiste plusieurs jours après l’arrêt du traitement.
→ Leur antidote est la vitamine K. En cas d’hémorragie grave, du concentré de complexe prothrombinique (CCP) est administré en urgence en association à la vitamine K.
Indications
Prévention thromboembolique
→ Du fait de leur délai d’action, les AVK ne sont pas des médicaments d’urgence, mais sont le plus souvent utilisés en relais des héparines. Ils sont indiqués dans :
– la prévention des accidents thromboemboliques liés à certains troubles du rythme auriculaire (fibrillation auriculaire notamment et certaines valvulopathies),
– la prévention des complications thromboemboliques des infarctus du myocarde, en relais des héparines,
– le traitement et la prévention des récidives des thromboses veineuses profondes et de l’embolie pulmonaire, en relais des héparines.
→ En raison d’une incidence plus élevée des accidents immunoallergiques, dont des atteintes rénales, avec la fluindione, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) recommande, depuis fin 2018, de ne plus instituer un traitement par fluindione, mais de privilégier la warfarine (l’acénocoumarol présentant, lui, l’inconvénient d’avoir une demi-vie plus courte).
Pharmacocinétique
Fort métabolisme hépatique
→ Les AVK sont de petites molécules liposolubles, ce qui leur confère une bonne biodisponibilité per os.
→ Ils ont une forte affinité pour l’albumine (taux de liaison à l’albumine d’au moins 90 %). Une fois sous forme libre, ils diffusent bien au travers des membranes biologiques, franchissent la barrière placentaire et passent dans le lait maternel (en particulier la fluindione).
→ Les AVK sont fortement métabolisés par le foie, principalement par oxydation. Leurs concentrations plasmatiques et leur effet sont donc très influencés par les interactions avec les médicaments inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques, d’autant plus qu’ils ont une marge thérapeutique étroite.
→ Ils sont éliminés essentiellement dans les urines. L’acénococoumarol a une demi-vie de 8 heures, celle de la fluindione est de 30 heures, celle de la warfarine de 40 heures.
Principaux effets indésirables
Hémorragies et risque tératogène
→ Les hémorragies représentent la complication la plus fréquente du traitement par AVK. Ils peuvent également induire des diarrhées, parfois seulement une alopécie (moins de 1 patient sur 1 000).
→ Rarement également, les AVK, en particulier la fluindione au cours des 6 premiers mois de traitement, sont à l’origine de manifestations d’hypersensibilité : urticaire, voire toxidermies graves, troubles médullaires ou néphrite tubulo-interstitielle. Elles sont non dose-dépendantes et imposent l’arrêt du traitement.
→ Les AVK sont tératogènes (risques de malformation des os propres du nez et des ponctuations épiphysaires) et fœtotoxiques (risque de fœtopathie cérébrale).
Contre-indications
Grossesse sauf exception
→ Les AVK sont contre-indiqués en cas d’insuffisance hépatique sévère.
→ Ils ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse, à l’exception de rares cas où leur poursuite est indispensable (prothèses valvulaires cardiaques, par exemple).
Principales interactions
Aspirine et AINS
→ Du fait d’un risque hémorragique, les AVK sont contre-indiqués avec l’aspirine aux doses anti-inflammatoires. Leur association aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou à l’aspirine aux doses antipyrétiques/antalgiques est déconseillée (contre-indiquée en cas d’antécédent d’ulcère digestif).
→ En raison de l’augmentation du risque hémorragique, ils sont contre-indiqués avec le miconazole par voie générale ou buccale et déconseillés avec le fluorouracile, la noscapine et le sulfaméthoxazole.
→ Ils sont contre-indiqués avec le millepertuis du fait d’un risque de thrombose par induction de leur métabolisme hépatique.
Surveillance
INR au minimum mensuel
→ Clinique : tout saignement mineur (hématomes, épistaxis, gingivorragies), majeur (présence de sang dans les urines ou les selles, vomissements ou crachats de sang) ou occulte (fatigue, dyspnée, pâleur) doit être signalé au médecin. La survenue de signes cliniques évocateurs de thrombose veineuse profonde (induration ou œdème du mollet), d’embolie pulmonaire (dyspnée et douleur thoracique), d’accident vasculaire cérébral (AVC), avec l’apparition de maux de tête violents, de troubles visuels ou de la parole, de déformation de la bouche, nécessitent une consultation médicale ou un appel téléphonique au 15 (si suspicion d’AVC ou d’embolie pulmonaire).
→ Biologique : le suivi biologique repose sur l’INR, qui, une fois le traitement stabilisé et l’intervalle cible atteint, doit être contrôlé au moins 1 fois par mois et 3 jours après l’ajout, la modification de posologie ou la suppression d’un médicament associé.
Sources : « Surveillance en vie réelle des anticoagulants oraux » et « Les anticoagulants en France en 2014 : état des lieux, synthèse et surveillance », ANSM, 2014 ; « Quelle place reste-t-il aux AVK ? », La Revue du Praticien, vol. 70, février 2020. Thésaurus des interactions médicamenteuses, ANSM, octobre 2020, base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr ; « Quoi de neuf concernant les antivitamines K ? », Questions/réponses pour les professionnels de santé, ANSM, 2018 ; « Inhibiteurs de la synthèse des facteurs vitamine K dépendants », pharmacomedicale.org ; Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (Gers), juin 2018.
Aller plus loin
L’INR
Définition. L’INR (pour International normalised ratio ou rapport normalisé international) est défini par la formule suivante :
C’est une valeur fiable, variant très peu d’un laboratoire à l’autre, contrairement au taux de prothrombine (TP ou facteur II) qui dépend du réactif de laboratoire utilisé. En l’absence d’un traitement anticoagulant, l’INR est aux alentours de 1, ce qui correspond à un TP à 100 %. Il augmente sous AVK au fur et à mesure que le TP diminue et que le temps de Quick du patient s’allonge.
Valeurs cibles. Dans la majorité des indications, l’INR doit se situer entre 2 et 3. Cependant, chez certains porteurs de prothèses valvulaires mécaniques, l’INR cible est plus élevé et compris entre 2,5 et 3,5, voire 3 et 4,5 dans le cas de prothèses mitrales.
Interprétation. Chez un patient sous AVK, un INR inférieur à l’intervalle cible indique que l’anticoagulation est insuffisante et qu’il y a un risque de thrombose. S’il est supérieur à l’intervalle cible, cela traduit une anticoagulation excessive et un risque hémorragique.
En pratique. L’INR est obtenu en analysant un échantillon de sang veineux. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour la prise de sang. Celle-ci est généralement faite le matin, ce qui permet, si besoin, d’ajuster sur avis médical la posologie de l’AVK le soir même. Cependant, en cas de saignements ou de suspicion de thrombose, elle peut être réalisée à tout moment de la journée.
- L’exercice physique est-il recommandé en cas de gonarthrose ?
- Régimes végétariens : quels effets sur la santé ?
- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?
- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?
- [VIDÉO] Accompagner le patient parkinsonien à l’officine