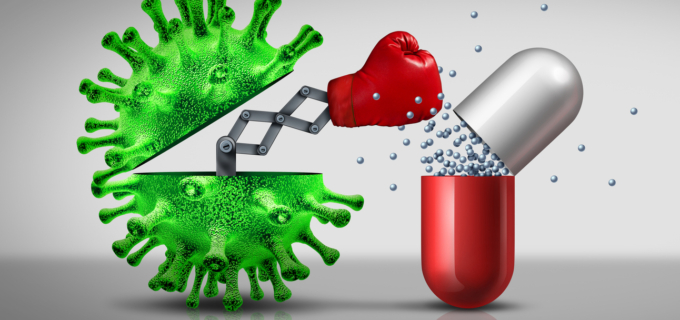- Accueil ›
- Conseils ›
- Maux du quotidien ›
- La vermifugation du chien et du chat
La vermifugation du chien et du chat
Vermifuger des chiens et des chats vise à détruire et expulser les vers parasites du tube digestif. Les antiparasitaires, choisis selon leur spectre d’action et les besoins de l’animal, s’accompagnent de règles d’hygiène.
Quels vers intestinaux ?
Les vers, ou « helminthes », susceptibles de coloniser le tube digestif des chiens et des chats sont classés en deux groupes.
• Les cestodes, dont le corps est plat. Ces vers ont une tête et une chaîne d’anneaux, ou « proglottis », qui se détachent au fur et à mesure de la croissance. Les anneaux, qui contiennent les œufs, sont évacués dans les selles, où ils sont parfois visibles, tels des pâtes plates ou des grains de riz écrasés. Parmi eux, les ténias (Taenia taeniaeformis, pisiformis…), jusqu’à 1 m de long adulte, le dipylidium (Dipylidium caninum), de 30 à 50 cm, et les échinocoques (Echinococcus granulosus, multilocularis), de 3 à 7 mm.
• Les nématodes, dont la section du corps est ronde en forme de spaghetti. Les ascaris (Toxocara canis, cati, leonida…), de 2 et 15 cm de long, les ankylostomes (Ancylostoma caninum, tubaeforme…), de 5 à 15 mm, et les trichures chez le chien (Trichuris vulpis…), environ 3 cm et en forme de point d’interrogation.
Comment s’infestent-ils ?
• La contamination se fait le plus souvent par ingestion des œufs de parasites présents dans les selles, dans le milieu extérieur : terre, végétaux… L’œuf devient larve dans l’animal, puis migre dans l’intestin, où, devenu adulte, il se nourrit du sang de l’hôte et libère à son tour des œufs dans les selles.
• D’autres voies sont possibles : transplacentaire durant la gestation, notamment des ascaris, par le lait, ce qui signifie que chiots et chatons naissent contaminés, transcutanée pour les larves d’ankylostomes.
• Pour les vers plats, un hôte intermédiaire est requis, les œufs libérés n’étant pas directement infestants. Le cycle du dipylidium a lieu chez une puce. Chats et chiens se contaminent en ingérant les puces lors du léchage. Les larves des ténias ou des échinocoques se développent chez les rongeurs, vaches, moutons ou porcs selon les espèces. Chats et chiens se contaminent en mangeant la viande ou les viscères crus.
Est-ce fréquent ?
Plus de la moitié des chiens et chats adultes et jusqu’à 90 % des chatons et chiots sont contaminés par des vers intestinaux. Les ascaris sont les plus fréquents, notamment chez les plus jeunes. Les animaux qui sortent et/ou mangent de la viande crue sont plus à risque, comme ceux qui vivent en zone endémique pour certains vers.
Quels sont les risques ?
• Pour l’animal. L’infestation peut être asymptomatique ou provoquer des troubles.
→ Troubles digestifs : diarrhées chroniques parfois sanglantes, notamment avec les trichures et ankylostomes, ou constipation, ballonnements, anorexie ou boulimie, vomissements. En nombre, les ascaris peuvent obstruer le tube digestif, voire le perforer, avec un risque létal.
→ Autres : poil terne, prurit…, toux si les larves d’ankylostomes migrent dans les poumons, prurit anal avec le « signe du traîneau » quand l’animal marche en frottant l’arrière-train au sol. Les retentissements possibles sont une baisse de forme, un amaigrissement et des retards de croissance chez les plus jeunes, une anémie.
• Pour l’homme. Certains parasites peuvent être transmis à l’homme (= zoonose).
→ Les ascaris : en avalant un œuf dans l’environnement, aires de jeux pour enfants, ou en manipulant son animal, l’homme peut développer une toxocarose, en général peu symptomatique, avec parfois un syndrome pseudo-grippal ou allergique. Chez l’enfant et l’immunodéprimé, après migration des parasites, les signes peuvent être plus sévères, avec troubles hépatiques, pulmonaires, digestifs, oculaires.
→ Les échinocoques peuvent entraîner une hydatidose. Après ingestion des œufs sur les végétaux ou via des mains sales, les larves s’enkystent dans le foie et les poumons, avec risque respiratoire, neurologique ou hépatique.
→ Le dipylidium se transmet aux hommes par une puce directement ou via la salive d’un animal contaminé. Les symptômes sont rares. La présence d’anneaux dans les selles justifie un traitement antiparasitaire.
→ La contamination humaine par des ankylostomes est rare, plutôt en zone tropicale, par voie transcutanée en marchant pieds nus. Elle peut causer une infection cutanée.
Qu’est-ce qu’un vermifuge ?
• Les vermifuges, ou anthelminthiques, sont des antiparasitaires qui détruisent le parasite et causent son expulsion dans les selles. Ils sont utilisés en curatif en cas d’infestation et en préventif pour éviter une contamination.
• Ils associent le plus souvent plusieurs molécules pour élargir le spectre d’action.
• Ce sont des médicaments délivrés en conseil, ou sur liste II nécessitant une ordonnance du vétérinaire, renouvelable sur une durée d’un an.
Quel mode d’action ?
La plupart des anthelminthiques sont neurotoxiques. Ils « paralysent » les parasites en déstabilisant l’action des neurotransmetteurs synaptiques (acétylcholine, adrénaline, GABA…) ou en bloquant directement la transmission de l’influx nerveux. D’autres perturbent le métabolisme énergétique du parasite, tels le niclosamide, le nitroscanate… Le praziquantel déstabilise les phospholipides membranaires, avec paralysie musculaire. Les benzimidazolés bloquent, eux, la division cellulaire.
Quelles molécules ?
Le spectre d’action varie selon les molécules, voire selon leur dosage.
• Pipérazine. Spectre : ascaris, mais suffisant pour traiter les plus jeunes dont l’ascaridiose est le risque principal. Exemples : Opovermifuge P sirop, Plurivers sirop…
• Pyrimidines : pyrantel, oxantel. Spectre : ascaris, ankylostomes. Exemples. Avec praziquantel : Dolpac, Anthelmin, Drontal, Multivermyx Biocanina, Veloxa… Avec fébantel : Ascatryl Trio.
• Lactones macrocycliques.
→ Milbémycines : milbémycine oxime. Spectre : ascaris, ankylostomes, trichures, et parasites externes (puces, gale des oreilles). Exemples. Seul : Interceptor. Avec praziquantel : Milbemax, Milbetel, Milprazikan, Milpro…
→ Avermectines : sélamectine et moxidectine. Sélamectine. Spectre : ascaris, ankylostomes et parasites externes (gale sarcoptique, puces, poux). Exemple : Stronghold. Moxidectine. Spectre : ascaris, ankylostomes, trichures. Exemple. Avec imidaclopride : Advocate Spot-on.
• Dérivés halogénophénoliques.
→ Niclosamide. Spectre : cestodes notamment, ténias et, à forte dose, dipylidium. Exemples. Seul : Féliténia. Avec pyrantel : Ascatene Biocanina. Avec lévamisole : Gelminthe Pâte orale, Clément vermifuge… Avec oxibendazole : Vitaminthe Gel oral.
→ Nitroscanate. Spectre : ascaris, ankylostomes, ténia, dipylidium. Exemples : Lopatol, Scanil, VermiScan…
→ Nitroxinil. Spectre : ankylostomes. Exemple : Dovenix.
• Praziquantel, dérivé de la pyrazinoisoquinoléine. Spectre : ténia, dipylidium et échinocoques. C’est la molécule de référence contre les échinocoques, d’où son association très fréquente aux autres molécules. Exemples. Avec milbémycine oxime : Milbemax, Milbetel, Milprazikan, Milpro… Avec pyrantel : Anthelmin, Drontal, Multivermyx Biocanina… Avec fébantel : Ascatryl Trio, Veloxa, Strantel… Avec axantel : Dolpac. Avec émodepside : Profender Spot-on.
• Émodepside. Spectre : ascaris, ankylostomes. Exemple. Avec praziquantel : Profender.
• Imidazolés.
→ Les benzimidazolés : albendazole, flubendazole, oxibendazole… et fébantel sont des prodrogues du fenbendazole. Spectre : variable selon les molécules, en général ascaris, ankylostomes, trichures et ténias. Exemples. Seuls : Biocanivers Pâte orale, Felivers, Flubenol… Avec niclosamide : Vitaminthe Avec pyrantel : Drontal Chien. Avec praziquantel : Ascatryl Trio, Veloxa, Strantel…
→ Lévamisole. Spectre : ascaris, ankylostomes. Exemples. Avec niclosamide : Gelminthe Pâte orale, Clément vermifuge…
Quelles présentations ?
• Par voie orale. Les comprimés, parfois appétants, sirops ou pâtes sont placés dans la gueule de l’animal, mélangés à un aliment, éventuellement écrasés, « cachés » dans une boulette ou déposés sur la patte pour léchage. En général, un jeûne de quelques heures est recommandé avant et après.
• Par voie transcutanée. Les principes actifs des spot-on ou « pipettes » passent à travers la peau, sont stockés dans le tissu graisseux sous-cutané, puis relargués dans la circulation. Après avoir écarté les poils, déposer le contenu de la pipette sur la peau entre les omoplates de l’animal pour éviter le léchage. Ne pas le laver ou le baigner durant quelques jours.
Lequel et pour qui ?
• Selon l’espèce. Tous ne sont pas indiqués chez le chien et le chat. Respecter les indications.
• Selon le risque.
→ Un animal en appartement ou un chien de chasse n’ont pas les mêmes risques d’infestation, ni ceux nourris avec des aliments industriels ou de la viande crue. Un vermifuge polyvalent est nécessaire en cas de risque accru.
→ Selon les régions, l’échinococcose étant endémique en Lorraine, dans les Alpes, le Massif central… le praziquantel s’impose.
→ En cas d’infestation par des puces et/ou par dipylidium, un traitement polyvalent parasites internes et externes peut être indiqué.
→ Donner à une femelle gestante un vermifuge qui couvre les risques d’ascaris transmissibles par voie placentaire.
• Selon l’animal.
→ Les formes orales conviennent à un animal qui se laisse manipuler, en cas de maladie de peau ou si plusieurs animaux vivent ensemble ou de jeunes enfants susceptibles de se lécher les mains après avoir joué avec l’animal traité.
→ Préférer les spot-on en cas d’animal difficile et d’insuffisance rénale ou hépatique.
À quelle posologie ?
• La posologie est fonction de l’espèce et du poids. Peser systématiquement l’animal pour vérifier son poids, en particulier pour les races naines car les surdosages sont fréquents.
• La durée de traitement varie selon la galénique ou les vers visés : en prise unique ou répétée sur quelques jours.
• Les pipettes graduées pour liquides et pâtes orales permettent d’ajuster la dose, notamment pour les petits animaux.
Quand et à quel rythme ?
Les vermifuges, peu rémanents, sont à renouveler régulièrement, que la présence de vers soit avérée ou non, y compris chez un animal d’intérieur. Traiter tous les animaux du foyer en même temps pour éviter les réinfestations.
• A minima en routine : dès l’âge de 2 semaines pour les chiots et les chatons, puis tous les quinze jours jusqu’à l’âge de 2 mois, puis une fois par mois jusqu’à 6 mois. Chez l’adulte, en moyenne tous les trois mois pour un animal qui sort et au moins deux fois par an pour les autres. Chez la femelle gestante : à la saillie, dans les quinze derniers jours de la gestation, puis au même rythme que les petits jusqu’au sevrage.
• Davantage dans certains cas : quinze jours avant une vaccination, en même temps qu’un antipuces, après un séjour en chenil, tous les mois en présence d’enfants jeunes ou immunodéprimés, avant pendant et après la chasse…
Quelles mesures en plus ?
• Litière. La changer régulièrement, ramasser les excréments à l’extérieur et les jeter rapidement. Ne pas les utiliser en compost.
• Alimentation. Éviter de donner de la viande crue non congelée et des rongeurs.
• Hygiène. Laver les mains des enfants après les jeux dans le sable ou avec des animaux. Aspirer et laver les sols de la maison régulièrement et les coussins et la corbeille de l’animal. Traiter l’animal et l’environnement régulièrement contre les parasites externes, puces notamment.
Avec l’aimable relecture de Florence Desachy, vétérinaire et autrice, entre autres, de l’ouvrage Conseils vétérinaires à l’officine pour les animaux de compagnie.
Info +
→ La mutation du gène MDR1, fréquente chez certaines races de chiens colley, berger australien, border collie…, entraîne une accumulation de molécules toxiques dans le cerveau, ce qui contre-indique l’utilisation des lactones macrocycliques et de l’émodepside. Dans le doute, conseiller d’autres molécules.
→ Pour faire avaler un comprimé : tenir la tête de l’animal inclinée vers l’arrière, ouvrir d’une main la gueule, baisser la mâchoire inférieure, puis placer le comprimé dans le fond de la gueule derrière le bombé de la langue, avant de masser la gorge pour provoquer un réflexe de déglutition.
Info +
→ Pour déclarer un effet indésirable d’un médicament vétérinaire : s’adresser à l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), chargée de la surveillance des produits vétérinaires. La télédéclaration en ligne est possible via pharmacovigilanceanmv.anses.fr
- L’exercice physique est-il recommandé en cas de gonarthrose ?
- Régimes végétariens : quels effets sur la santé ?
- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?
- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?
- [VIDÉO] Accompagner le patient parkinsonien à l’officine
- « Pharmacien à la campagne, ça me va très bien »
- Biomedinfo, le site de référence pour les biosimilaires
- Nouvelles missions : la vision de Valérie Kieffer (Giphar) sur l’apport des coopératives
- Nimenrix et MenQuadfi : 2 aiguilles, pour quoi faire ?
- Vendre son officine : une transition à ne pas improviser