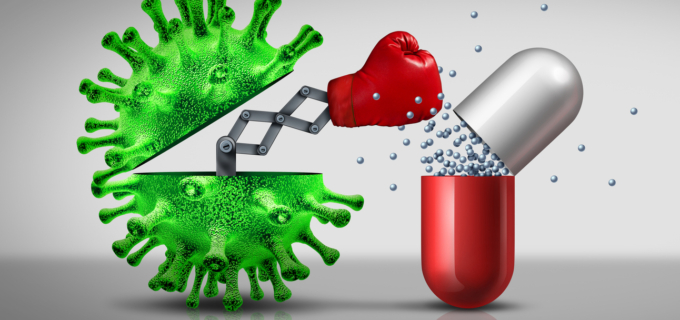- Accueil ›
- Conseils ›
- Maux du quotidien ›
- Coups de soleil : les bons réflexes au comptoir

© Getty Images/iStockphoto
Coups de soleil : les bons réflexes au comptoir
Fréquents en été, les coups de soleil ne sont pas à prendre à la légère. Découvrez les bons réflexes à adopter au comptoir pour soulager efficacement vos patients et prévenir les complications.
Le degré de gravité d’un coup de soleil est évalué selon les signes cliniques et l’évolution. Une brûlure thermique est majoritairement due aux ultraviolets B ou UVB (soleil ou cabine de bronzage). Elle apparaît lorsque le système de défense cutanée est dépassé, quelques heures après une exposition.
Le contexte- Brûlures superficielles : l’érythème disparaît à la pression. La brûlure du premier degré se manifeste par une inflammation superficielle de l’épiderme, un érythème, de la chaleur, une douleur, éventuellement un œdème et des démangeaisons. L’évolution est favorable en quelques jours sans cicatrice, après une éventuelle desquamation. Au deuxième degré superficiel, la brûlure atteint le derme en superficie et se manifeste par l’apparition de phlyctènes (cloques) de liquide transparent dans les 24 heures, une rougeur et une douleur du plancher (fond de la cloque) et de la peau alentour. La lésion cicatrise en deux semaines en moyenne après desquamation.
- Brûlures profondes : l’érythème ne blanchit pas à la pression. Les lésions comprennent des atteintes de l’hypoderme. Elles sont dites de degré 2 profond ou 3, peu douloureuses (les terminaisons nerveuses étant détruites), avec des cloques dont le plancher est blanc-rosé et la peau peut présenter un aspect cireux. La guérison est plus longue et peut nécessiter des soins médicaux et générer une cicatrice.
- Autres signes : fièvre, frissons, céphalées peuvent survenir, notamment en cas d’atteinte étendue. Une infection est possible en cas d’effraction cutanée ou de cloque percée.
- Effets retardés : risques de cancer cutané et vieillissement cutané photo-induit.
Évaluer la gravité
Commencez par poser des questions pour cibler le conseil et évaluer la gravité : « Où est localisé le coup de soleil et sur quelle étendue ? Y a-t-il des cloques ? De quelle taille sont-elles ? Sont-elles douloureuses ? Des signes ou des risques d’infection sont-ils apparus ? »
Le cas échéant : « La vaccination antitétanique est-elle à jour ? Souffrez-vous d’autres maux tels qu’une fièvre, des frissons, une soif intense, une forte fatigue ou un mal de tête ? »
Continuez à investiguer pour écarter les autres causes et évaluer le risque de photodermatose (phototoxicité, photoallergie, lucite estivale) : « Prenez-vous un traitement actuellement ? Avez-vous appliqué un cosmétique avant l’exposition ? Souffrez-vous habituellement d’allergie au soleil ? »
En cas de brûlure de premier degré et à l’instar de toute brûlure, la consultation médicale est nécessaire quand la lésion dépasse 10 % de la surface corporelle (une paume représente 1 %) – en raison, notamment, d’un risque de déshydratation lié aux pertes liquidiennes – et/ou si les cloques dépassent 2 à 3 cm (environ une pièce de 2 euros). Elle est recommandée chez les jeunes enfants et doit être systématique chez les nourrissons, les personnes âgées fragiles et/ou polymédiquées et en cas de suspicion d’un coup de chaleur associé (soif, apathie, céphalées…). Un avis médical est préférable en cas de lésion autour des yeux, des organes génitaux, de signes infectieux, de vaccination antitétanique non à jour s’il y a effraction cutanée ou de suspicion de photodermatose.
Coups de soleil : les premiers gestes à adopter- Nettoyer les lésions à l’eau claire et au savon, laisser sécher à l’air libre ou tamponner avec un linge propre.
- Refroidir la douleur pour la soulager : douche tiède, brumisateur d’eau thermale, linge humide… à poursuivre de façon pluriquotidienne quand le besoin se fait sentir. Ne pas utiliser de glace ou d’eau glacée qui peuvent aggraver les lésions voire provoquer une hypothermie.
- Jusqu’à cicatrisation, les topiques et pansements soulagent et protègent la lésion et favorisent la régénération cutanée.
- Le paracétamol ou l’ibuprofène peuvent être conseillés, à dose efficace la plus faible et sur la durée la plus courte possible, une fois écartés les risques de déshydratation ou de coup de chaleur.
Choisir le bon traitement
Les topiques émollients : crème, pommade, gel, gel-crème ou onguent, composés d’une base hydratante plus ou moins associée à des corps gras (vaseline – qui peut être utilisée seule –, huiles végétales, cires…) sont indiqués. Ils soulagent, limitent la déshydratation locale, restaurent le film hydrolipidique et favorisent ainsi la régénération cutanée.
Les produits contiennent souvent des actifs additionnels : protecteurs cutanés comme la trolamine qui, associée à des acides gras, a des propriétés occlusives et hydratantes (Biafineact, Trolamine Conseil…) ; filmogènes, comme l’acide hyaluronique, dont le pouvoir hygroscopique favorise un environnement humide propice à la cicatrisation (Ialuset Crème acide hyaluronique, Cicatridine, Cicanov+, Dexeryl Specific Brûlures et coups de soleil…), ou associés à des polymères isolants (Uriage Bariéderm Crème isolante réparatrice) ; apaisants à visée anti-inflammatoire comme l’enoxolone ou l’allantoïne (Bioderma Créaline Fort) ; antibactériens purifiants tels l’oxyde et le sulfate de zinc ou le sulfate de cuivre (Cicalfate+ Crème réparatrice protectrice, Topicrem Cica+, Agathol, Brulex…). Certains ingrédients « naturels » sont utilisés : postbiotiques issus d’eau thermale à visée régénérative cutanée (Cicalfate+ Crème réparatrice protectrice) ; plantes (calendula, aloe vera, millepertuis…), huiles essentielles (lavande aspic, hélichryse, arbre à thé, géranium…) apaisantes et cicatrisantes (dans Calendula naturel Crème, Cicaderma, Calendoron, Macérat huileux de millepertuis Aroma-zone, Gel Bobos Bosses Puressentiel…) ou miel antiseptique et cicatrisant (Revamil Gel, CicaManuka, Melectis, Baume cicatrisant Miel Urgo…).
Les hydrogels sont composés d’eau et d’actifs à effet osmotique élevé (qui permet d’attirer les molécules d’eau des couches inférieures de l’épiderme vers les couches superficielles), tels les hydrocolloïdes ou des carbomères qui maintiennent un milieu humide (Bepanthen Pro Hydrogel, Osmosoft Brûlures et coups de soleil, Flamigel, Purilon…).
Les corticoïdes topiques à base d’hydrocortisone peuvent être indiqués sur un coup de soleil localisé, en particulier en cas de fortes démangeaisons, si la peau n’est pas lésée (Cortisédermyl, Dermofenac Démangeaisons, Cortapaisyl…).
Les pansements ont l’avantage de protéger contre les souillures – donc contre le risque infectieux – et de limiter les douleurs dans les zones à risque de frottement. Ne pas utiliser de pansements secs, l’objectif étant de créer un milieu humide favorable à la cicatrisation :
- imprégnés de vaseline, à réaliser soi-même avec une couche de vaseline et des compresses stériles ou pré-imprégnées (Grassolind tulle gras, MédiTulle…), parfois associées à des lipodocolloïdes (Urgo Brûlures-Blessures superficielles). Hydrocolloïdes (Duoderm…) ou hydrogels (DermaPlast Effect Brûlures, Hydrotac Comfort…) sous film de polyuréthane ;
- imprégnés de miel médical (Revamil Tulle, Urgo Pansements cicatrisants miel…).
Selon la gravité, proposez un topique émollient ou un hydrogel sur une brûlure de degré 1 et des pansements sur des lésions de degré 2 peu étendues (cloques).
Selon les particularités :
- forte sensation de chaleur : préférer les gels et les hydrogels ;
- zone brûlée peu étendue dans une zone de frottement : pansements ;
- démangeaisons fortes sur une zone peu étendue : hydrocortisone pendant 3 jours maximum, relais par un topique émollient ou hydrogel (pas d’hydrocortisone chez l’enfant de moins de 6 ans) ;
- enfants, femmes enceintes, antécédents de convulsions : produits sans dérivés terpéniques (menthol, huiles essentielles…) ;
- allergies : attention notamment à la présence de baume du Pérou ou de lanoline ;
- douleur insomniante et/ou de maux de tête : ajouter un antalgique oral.
Les traitements favorisant la cicatrisation doivent être poursuivis jusqu’à la guérison complète, même si la douleur diminue. Contre la douleur, alterner les traitements cicatrisants avec des applications d’eau fraîche. Surveiller l’évolution des lésions, notamment les cloques : ne pas les percer ni forcer la desquamation quand la peau pèle. Consulter en cas de signes d’infections.
Conseils pour favoriser la guérison- Boire davantage : s’hydrater compense les pertes hydriques dues à la brûlure
- Gare au soleil ! Ne pas réexposer les lésions au soleil, même en cas de temps nuageux. Après guérison, appliquer une protection solaire d’indice élevé en cas d’exposition inévitable.
- Sensibiliser au bon usage des topiques : les appliquer en couches épaisses et masser doucement jusqu’au refus de la peau. Renouveler l’application plusieurs fois par jour (sauf avec la cortisone : limiter à deux applications maximum par jour en touches espacées, pendant trois jours). Placer les gels et gel-crème au réfrigérateur pour un effet frais apaisant.
- Bon usage des pansements : la compresse doit déborder de la zone brûlée pour un retrait atraumatique. Utiliser si besoin un pansement imperméable au-dessus des tulles imprégnés. Vérifier que la lésion ne s’infecte pas en changeant les pansements une fois par jour au début, puis tous les deux jours. Les hydrogels et hydrocolloïdes peuvent être laissés en place plusieurs jours de suite en l’absence d’infection.
- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?
- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?
- [VIDÉO] Accompagner le patient parkinsonien à l’officine
- Régimes végétariens : quels effets sur la santé ?
- L’exercice physique est-il recommandé en cas de gonarthrose ?
- La question des remises sur les génériques toujours d’actualité
- Déploiement de la carte Vitale numérique : les pharmaciens sont-ils prêts ?
- Vanflyta : 4 points clés sur ce nouveau traitement de la leucémie aiguë myéloïde
- L’arsenal de mesures du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux soignants
- [VIDÉO] Vers un nouvel avenant conventionnel ? La Cnam temporise