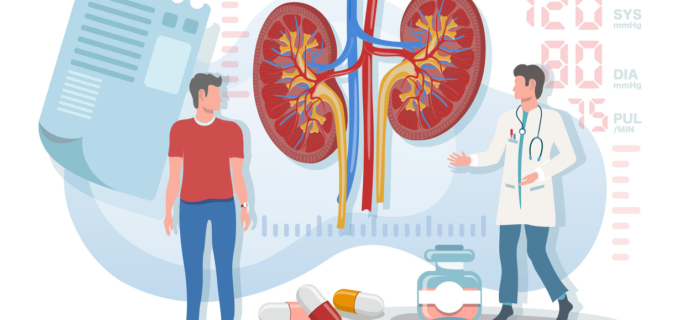- Accueil ›
- Thérapeutique ›
- Médicaments ›
- Recherche et innovation ›
- Les antidépresseurs imipraminiques
Les antidépresseurs imipraminiques
Tenant leur nom de leur chef de file, l’imipramine, première molécule identifiée comme ayant des vertus antidépressives en 1957, les antidépresseurs imipraminiques sont également appelés tricycliques en raison de leur structure chimique. Ce sont désormais des antidépresseurs de seconde intention.
Mode d’action
Action mixte adrénergique-sérotoninergique
Les antidépresseurs imipraminiques inhibent, de façon plus ou moins sélective selon les molécules, la recapture présynaptique de la sérotonine et/ou de la noradrénaline. Ils augmentent donc les concentrations de ces monoamines dans les fentes synaptiques.
Ils ont également des effets postsynaptiques importants au niveau central (action antihistaminique et anticholinergique) et/ou périphérique (anticholinergique et adrénolytique via un blocage des récepteurs α périphériques). Ces différentes actions expliquent leurs nombreux effets indésirables.
Indications
Antidépresseurs de seconde intention
Les antidépresseurs imipraminiques sont indiqués lors d’épisodes dépressifs majeurs. En raison de leurs effets indésirables (cardiaques en particulier, mais aussi atropiniques mal tolérés dans la population âgée), ils constituent un traitement de seconde intention, utilisable en cas d’échec des autres antidépresseurs.
L’amitriptyline, la clomipramine et l’imipramine sont également indiquées dans le soulagement des douleurs neuropathiques et l’énurésie (non remboursés dans cette indication).
L’amitriptyline l’est aussi en traitement de fond de la migraine et en traitement prophylactique des céphalées de tension.
La clomipramine a une indication dans les troubles obsessionnels compulsifs et la prévention des attaques de panique.
Pharmacocinétique
Molécules liposolubles
Les antidépresseurs imipraminiques sont des molécules liposolubles qui subissent un important effet de premier passage hépatique, ce qui explique que leur biodisponibilité orale soit réduite de moitié environ par rapport à leur biodisponibilité parentérale.
Du fait de leur liposolubilité, ces molécules circulent dans le sang sous forme liée aux protéines plasmatiques et diffusent facilement et rapidement dans les tissus. Elles passent la barrière hématoencéphalique, le placenta et dans le lait maternel.
Les antidépresseurs imipraminiques sont fortement métabolisés au niveau hépatique, sous forme de métabolites actifs, dont les demi-vies sont plus importantes que celle de la molécule mère (jusqu’à 50 heures selon les métabolites).
L’élimination se fait par voie urinaire et fécale avec des cycles entérohépatiques qui contribuent à allonger les demi-vies.
Effets indésirables
Atropiniques et cardiaques
Comme tous les antidépresseurs, les imipraminiques peuvent induire une levée d’inhibition avec un risque de passage à l’acte suicidaire en début de traitement.
Du fait de leur action anticholinergique, ils provoquent des troubles atropiniques périphériques et centraux : sécheresse buccale, rétention urinaire, constipation, troubles de l’accommodation et mydriase, confusion, désorientation.
Ils exposent à des effets cardiovasculaires : hypotension orthostatique, bouffées de chaleur en raison des blocages des récepteurs vasculaires α, tachycardie (liée à l’effet anticholinergique et également réactionnelle à l’hypotension) et troubles du rythme avec allongement de l’intervalle QT. En lien avec un effet stabilisant de membrane (voir encadré), ces troubles du rythme justifient la réalisation d’un électrocardiogramme avant l’instauration du traitement chez les patients de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risque cardiaque. L’effet stabilisant de membrane explique que l’intoxication à ces molécules (pouvant provenir d’un surdosage volontaire dans le cadre d’une tentative de suicide) soit particulièrement dangereuse.
Les antidépresseurs imipraminiques peuvent être responsables de troubles neuropsychiques (somnolence liée à l’action antihistaminique H1, et, plus rarement, convulsions par diminution du seuil épileptogène) et d’une prise de poids du fait de l’effet anti-H1 (diminution du seuil de satiété).
Contre-indications
Glaucome et adénome de prostate
Les antidépresseurs tricycliques sont contre-indiqués en cas de risque de glaucome par fermeture de l’angle, de rétention urinaire déclenchée par des troubles urétroprostatiques (adénome de la prostate, par exemple) et d’infarctus du myocarde récent. Chez la femme enceinte, si un tricyclique s’avère nécessaire, le Centre de référence sur les agents tératogènes (Crat) préconise l’amitriptyline ou la clomipramine, molécules pour lesquelles les données sont nombreuses et rassurantes.
L’allaitement est à éviter pendant le traitement. Cependant, selon le Crat, l’utilisation de l’amitriptyline et de la clomipramine est possible chez une femme qui allaite en raison d’un passage faible dans le lait (l’enfant reçoit de 2 à 4 % environ de la dose maternelle selon les molécules).
Interactions
Pas d’association aux IMAO
Les antidépresseurs imipraminiques sont contre-indiqués avec les inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) irréversibles (iproniazide en ville) et déconseillés avec les IMAO-A (moclobémide en ville) en raison d’un risque de survenue d’un syndrome sérotoninergique : troubles digestifs, tremblements, sueurs, troubles tensionnels, altération de conscience.
Leur association aux antihypertenseurs d’action centrale (clonidine par exemple) est déconseillée (diminution de l’effet antihypertenseur par antagonisme adrénergique) comme celle aux sympathomimétiques injectables (risque d’hypertension paroxystique).
L’association avec des médicaments abaissant la pression artérielle, sédatifs, ayant un effet atropinique, un effet sérotoninergique, allongeant l’intervalle QT ou abaissant le seuil épileptogène (comme certains neuroleptiques) requiert la prudence (risque d’addition d’effets indésirables de même nature).
L’effet stabilisant de membrane
Certaines molécules liposolubles interagissent avec la bicouche phospholipidique des membranes cellulaires et réduisent les courants ioniques transmembranaires. On parle d’effet stabilisant de membrane. Modifiant les propriétés électrophysiologiques des cellules, cet effet concerne notamment les cellules myocardiques et celles du système nerveux central.
L’effet stabilisant de membrane peut être recherché en thérapeutique : c’est le cas avec les anesthésiques ou les antiarythmiques de classe I comme la quinidine, expliquant que cet effet soit aussi appelé « effet quinidine-like ».
Il apparaît aussi comme un effet indésirable de certains médicaments : c’est le cas notamment avec les antidépresseurs tricycliques, mais également les neuroleptiques phénothiaziniques, la chloroquine et la quinine. C’est aussi un effet toxique de la cocaïne.
L’effet stabilisant de membrane a des conséquences cliniques. Des troubles de la repolarisation cardiaque avec allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme, des troubles de la conduction auriculoventriculaire et des troubles du rythme cardiaque (torsades de pointes, tachycardie ventriculaire) qui peuvent être graves, notamment en cas de surdosage, ont été observés. Il peut également être à l’origine de troubles de la vigilance, d’une confusion ou de convulsions, voire d’un coma.
- Sources : « Imipraminiques », Collège national de pharmacologie médical, pharmacomedicale.org ; Crat, lecrat.fr ; Le guide Prescrire des interactions médicamenteuses ; thésaurus des interactions médicamenteuses, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; base de données publique des médicaments ; C. Brasse et coll., « L’effet stabilisant de membrane : quelles conséquences et quels traitements ? », Société française de médecine d’urgence, 2008.
- Miorel et génériques : contraception obligatoire pour tous
- Quétiapine : vers la dispensation à l’unité et des préparations magistrales
- Médicaments à base de pseudoéphédrine : un document obligatoire à remettre aux patients
- 3 000 patients bénéficieront de Wegovy gratuitement
- Ryeqo : traitement de l’endométriose en 5 points clés