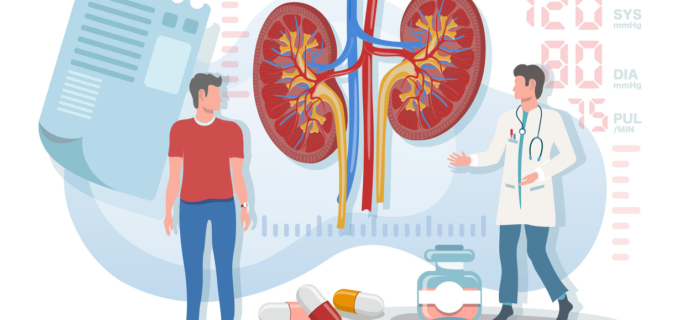- Accueil ›
- Formation ›
- Cahiers Iatrogénie ›
- Les antiarythmiques ›
- L’essentiel à retenir sur l’iatrogénie des antiarythmiques

© Getty Images
Les antiarythmiques
Réservé aux abonnés
L’essentiel à retenir sur l’iatrogénie des antiarythmiques
Partager
Mettre en favori
Retrouvez les informations clés du cahier Formation qui détaille l’iatrogénie des antiarythmiques.
Y a-t-il des effets indésirables ?
Les antiarythmiques constituent une classe de médicaments hétérogènes, tant par leur structure chimique que par leur mode d’action. Ils exposent à de nombreux effets indésirables qu’il faut savoir prévenir et repérer.
Antiarythmiques de classe Ic
- Le flécaïnide est très fréquemment responsable d’altérations visuelles (vision trouble, diplopie) dont la sévérité justifie parfois son remplacement par une autre molécule antiarythmique et incite à la prudence vis-à-vis de la conduite automobile.
- La propafénone est susceptible d’induire des troubles digestifs en début de traitement, généralement transitoires.
Antiarythmiques de classe II
- Les ß-bloquants liposolubles provoquent parfois des cauchemars et des insomnies. Une prise le matin et une réduction de la dose prescrite permettent généralement de limiter leur survenue.
- En raison de leurs propriétés vasoconstrictrices, les ß-bloquants non cardiosélectifs entraînent, dans certains cas, une impuissance.
Antiarythmiques de classe III
- L’amiodarone peut être responsable, sur le long terme, de photosensibilisation et d’hyperpigmentation bleue ou grisâtre de la peau. Une protection solaire est indispensable.
- Elle est également à l’origine d’une hypothyroïdie chez certaines personnes. Une substitution par lévothyroxine est parfois nécessaire. À l’inverse, chez d’autres patients, la survenue d’une hyperthyroïdie est observée jusqu’à plusieurs mois après la fin de leur traitement. Si elle survient en cours de la prise d’amiodarone, elle impose son arrêt.
Antiarythmiques de classe IV
- Le vérapamil et le diltiazem, antagonistes calciques bradycardisants, sont susceptibles d’engendrer une hyperplasie gingivale et des gingivopathies réversibles à l’arrêt du traitement, ainsi qu’une constipation.
- Du fait de leurs propriétés vasodilatatrices, ces molécules sont fréquemment responsables de bouffées vasomotrices et de céphalées en début de traitement.
Quel est le profil du patient ?
- Les ß-bloquants peuvent induire des éruptions psoriasiformes ou aggraver un psoriasis, ce qui impose d’évaluer la pertinence de ce traitement chez les patients souffrant de la pathologie.
- Chez les patients atteints d’asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive, la prise de ß-bloquants non sélectifs sont contre-indiqués en raison de leur capacité à provoquer des dyspnées et des bronchospasmes. Les molécules cardiosélectives sont contre-indiquées chez les personnes présentant des formes sévères.
Y a-t-il des interactions ?
- La colchicine est déconseillée en association avec le vérapamil. Cet antiarythmique, inhibiteur enzymatique, expose à un risque d’augmentation des concentrations plasmatiques et de surdosage en colchicine.
- Les antiarythmiques de classe III (amiodarone et dronédarone, notamment) peuvent allonger l’intervalle QT à l’électrocardiogramme (ECG) : leur association aux autres torsadogènes est, selon le cas, contre-indiquée ou déconseillée.
- L’association des laxatifs stimulants, susceptibles d’induire une hypokaliémie, et de médicaments bradycardisants est à éviter, en raison d’un risque de torsades de pointe.
- Les ß-bloquants masquent certains signes typiques d’hypoglycémie. Alerter les patients traités par insuline ou antidiabétiques oraux insulinosécréteurs à repérer les symptômes évocateurs
Article issu du cahier Formation du n°3530, paru le 5 octobre 2024.
- Vaccination antigrippale des plus de 65 ans : Efluelda aurait-il tout changé cette année ?
- Miorel et génériques : contraception obligatoire pour tous
- Enquête de l’Anepf : la vie des étudiants en pharmacie, pas si rose
- Analogues du GLP-1 : période d’essai jusqu’au 1er mai
- Économie officinale : faut-il ressortir les gilets jaunes et les peindre en vert ?
Sur le même sujet…