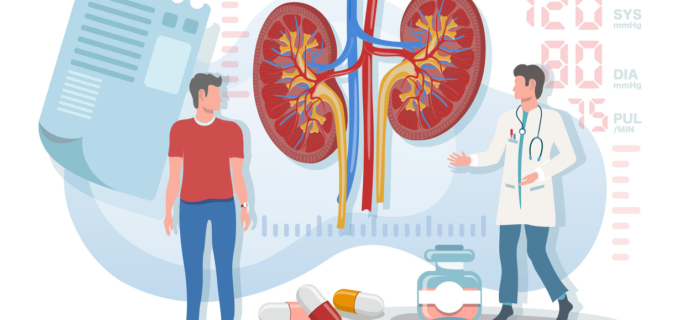- Accueil ›
- Préparateurs ›
- Savoirs ›
- les fibromes utérins
les fibromes utérins
Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes fréquentes. Asymptomatiques dans nombre de cas, ils peuvent aussi grandement altérer la qualité de vie, et doivent alors être traités par voie médicamenteuse ou chirurgicale.
Définition
Les fibromes sont des tumeurs musculaires bénignes constituées de tissu conjonctif et de tissu musculaire lisse. Ils ont l’aspect d’une masse charnue et ferme, blanchâtre. Le volume peut varier de celui d’un pois à celui d’un pamplemousse et le diamètre de quelques millimètres à plusieurs centimètres.
C’est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer et sa prévalence augmente à partir de 30 ans : 30 % des femmes de plus de 35 ans sont susceptibles d’avoir un fibrome utérin. La fréquence des fibromes est supérieure chez les femmes noires. Chez ces dernières, les fibromes s’observent aussi à un âge plus jeune que chez les femmes caucasiennes.
Les différents fibromes utérins
En fonction de leur localisation, on distingue trois grands types de fibromes :
• les fibromes interstitiels ou intra-muraux. Ils se forment dans la couche musculaire de la paroi de l’utérus ; ce sont les plus fréquents (70 % des cas) ;
• les fibromes sous-muqueux. Ils se développent sous la muqueuse de l’utérus, dans la cavité utérine ;
• les fibromes sous-séreux. Ils se développent vers l’extérieur de l’utérus (voir infographie).
Les signes cliniques
Dans près de la moitié des cas, les fibromes sont asymptomatiques. Ils sont alors découverts fortuitement au cours d’une visite gynécologique de routine, ou à l’échographie. En cas d’expression clinique, les symptômes peuvent être très divers. Il peut s’agir de :
• saignements anormaux en cas de fibromes interstitiels ou sous-muqueux : comme des ménorragies (règles d’abondance et de durée accrues) dans un tiers des cas, ou des métrorragies (saignements intermenstruels). Ces hémorragies peuvent être à l’origine d’une anémie ;
• douleurs pelviennes : chroniques ou aiguës et associées à de la fièvre, en cas de complications du fibrome.
• signes de compression des organes avoisinants lorsque le fibrome est volumineux : compression des uretères ou de la vessie, entraînant des difficultés à uriner ou des envies fréquentes d’uriner ; et compression de l’intestin provoquant une constipation ;
• douleurs lors des rapports sexuels.
Stratégie thérapeutique
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a fixé en 2004 les dernières recommandations concernant la prise en charge des fibromes :
– un fibrome qui ne provoque pas de symptômes ne justifie pas de traitement ;
– s’il mesure moins de 10 cm, il ne requiert pas de surveillance particulière ;
– en cas de fibrome asymptomatique volumineux, une surveillance gynécologique rigoureuse est nécessaire pour suivre son évolution ;
– seuls les fibromes symptomatiques doivent donc être traités.
Le traitement, médicamenteux ou chirurgical, dépend du nombre et du type de fibromes et, avant tout, de l’âge de la patiente et de son désir de préserver sa fertilité.
Un fibrome sous-muqueux ne relève jamais d’un traitement médicamenteux, mais constitue toujours une indication chirurgicale.
Dans le cas de fibromes interstitiels et/ou sous-séreux, le traitement peut être chirurgical, médicamenteux ou combiner plusieurs traitements.
Traitement médicamenteux
Les médicaments permettent de limiter les symptômes ou de préparer une intervention chirurgicale, mais ils ne font pas disparaître les fibromes.
Traitement symptomatique
• Les progestatifs (chlormadinone, médrogestone…)
Mode d’action : de par leur action anti-oestrogénique, ils permettent une baisse des saignements, mais ne réduisent pas le volume des fibromes et n’empêchent pas leur croissance. Contre-indications : accidents thrombo-emboliques en évolution, altération grave de la fonction hépatique.
• Les antifibrinolytiques (acide tranexamique)
Mode d’action : ils inactivent la plasmine, ce qui empêche la dissolution de la fibrine, et assure une action anti-hémorragique. Contre-indications : l’acide tranexamique est contre-indiqué en cas d’antécédents thrombo-emboliques veineux ou artériels, et d’insuffisance rénale grave.
• L’acide méfénamique (Ponstyl)
Mode d’action : c’est un AINS utilisé pour son action anti-inflammatoire et antalgique. Administration : préférentiellement au cours des repas, pour améliorer sa tolérance digestive. Contre-indications : grossesse à partir du cinquième mois, antécédents d’allergie ou d’asthme induits par la prise d’AINS ou d’aspirine, insuffisances rénales ou hépatiques sévères, ulcère gastro-duodénal en évolution.
Traitement préopératoire
• Les analogues de la Gn-RH (leuproréline, triptoréline)
Ils sont utilisés pour préparer une intervention chirurgicale car ils arrêtent les règles et réduisent le volume des fibromes.
Mode d’action : grâce à leur analogie structurale avec la Gn-RH, ils agissent sur l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Dans un premier temps, ils provoquent une hyperoestrogénie transitoire, qui déclenche au bout de deux semaines, un rétro-contrôle négatif, avec suppression de sécrétion de FSH et de LH , générant ainsi une véritable « castration chimique » et une aménorrhée permettant de corriger une anémie ferriprive. Les analogues de la Gn-RH causent également une diminution de la taille des fibromes ce qui facilite une intervention chirurgicale. Administration : une fois par mois, pendant trois mois en IM ou SC pour Enantone et Gonapeptyl ; en revanche, Décapeptyl s’administre uniquement en IM. La première injection est à réaliser dans les cinq premiers jours du cycle. La diminution du volume du fibrome apparaît dès six à huit semaines de traitement et l’effet maximal est obtenu au troisième mois de traitement. Conservation : Gonapeptyl se garde au réfrigérateur entre + 2 et + 8 °C, tandis qu’Enantone et Décapeptyl se conservent à température ambiante. Contre-indications : Gonapeptyl est contre-indiqué en cas de grossesse ou d’ostéoporose.
• Le fer
Mode d’action : le fer permet d’augmenter le taux d’hémoglobine et de corriger une anémie. Administration : il est préférable d’administrer le fer à jeun pour en améliorer l’absorption. La dose peut être fractionnée afin de limiter les effets indésirables digestifs. Il convient de ne pas garder trop longtemps les formes liquides en bouche, afin de prévenir un possible noircissement des dents. Contre-indications : anémie normo– ou hypersidérémique, hémochromatose.
Traitement chirurgical
Il est principalement indiqué en cas de saignements incontrôlables, d’infertilité, de fortes douleurs abdominales ou pelviennes. Il peut être conservateur de l’utérus ou radical.
Les techniques conservatrices
• L’embolisation
C’est une technique radiologique interventionnelle qui se distingue de la chirurgie à proprement parler. Elle vise à « dessécher » les fibromes sans les enlever. Pratiquée sous anesthésie locale, l’embolisation consiste à obstruer le plexus artériel irriguant l’utérus grâce à des microparticules synthétiques injectées via une petite ouverture pratiquée au pli de l’aine. Bien que douloureuse, c’est une technique moins pénible que la myomectomie (voir ci-dessous). Une hospitalisation de 24 à 48 heures et une convalescence de sept à dix jours sont suffisantes avant de pouvoir reprendre une activité normale.
• La myomectomie
Elle vise à retirer uniquement le(s) fibrome(s). Pratiquée sous anesthésie générale, la myomectomie peut être réalisée :
– par hystéroscopie : c’est-à-dire sans incision, par voie vaginale avec l’aide d’un endoscope, pour les fibromes sous-muqueux de petite taille ;
– par coelioscopie : pour les fibromes sous-séreux ou interstitiels de taille inférieure ou égale à 8 cm, et de nombre inférieur ou égal à deux ;
– par laparotomie avec incision de l’abdomen et de l’utérus, dans les autres cas.
La myomectomie a l’avantage de sauvegarder l’utérus, et donc de permettre à une femme qui le souhaite d’avoir des enfants, mais elle présente l’inconvénient de laisser un utérus cicatriciel et de n’être pas toujours définitive : dans 15 % des cas, les fibromes peuvent réapparaître. La myomectomie requiert une hospitalisation de 12 à 24 heures et peut nécessiter un mois de convalescence.
• La myolyse coelioscopique
Pratiquée sous anesthésie générale, cette technique, douloureuse, consiste à dévasculariser les fibromes sous contrôle endoscopique, pour diminuer leur taille, par cautérisation au moyen de radiofréquence ou de tirs au laser YAG. Les patientes peuvent, dans la plupart des cas, rentrer chez elles le jour même, et la convalescence dure une quinzaine de jours.
L’hystérectomie
Elle consiste à l’ablation de l’utérus chez des patientes ne souhaitant plus de grossesse. Elle est essentiellement indiquée en cas de fibromes volumineux, entraînant des métrorragies et des syndromes de compression. Elle est réservée aux cas les plus lourds, lorsqu’il n’existe pas d’autres alternatives thérapeutiques. L’hystérectomie peut être totale ou partielle (avec conservation du col de l’utérus). Elle nécessite une anesthésie locale ou générale, et la voie d’abord est vaginale ou abdominale.
Cette opération présente l’avantage de ne présenter aucun risque possible de récidive, mais elle est difficile à vivre par les patientes, tant psychologiquement que physiquement, car les suites chirurgicales sont douloureuses et requièrent au moins quatre semaines de convalescence.
Vie quotidienne
Douleurs
Les douleurs sont majorées par la station debout prolongée et sont calmées par le repos en position allongée.
Alimentation
• Pour lutter contre l’anémie
Il faut éviter de boire trop de café ou de thé, car ils diminuent l’absorption du fer. Au contraire, l’absorption du fer étant facilitée par la vitamine C, il convient de consommer des agrumes et des kiwis. Privilégier également la prise d’aliments riches en fer tels que les abats et le foie en particulier, la viande rouge, les lentilles et les légumes secs…
• Pour limiter la constipation
La constipation peut être due au fibrome et peut aussi être majorée par un traitement à base de fer. Il est donc particulièrement important de savoir prodiguer les conseils adéquats : boire suffisamment, compléter l’apport hydrique d’un peu d’eau d’Hépar, riche en magnésium, et d’un verre de jus d’orange, pris le matin à jeun pour déclencher le péristaltisme intestinal ; manger des aliments riches en fibres : crudités, fruits, légumes verts, céréales complètes et éviter le riz, les pâtes, le chocolat ; adopter des horaires réguliers pour aller à la selle ; conseiller aux patientes – dans la limite des douleurs et des saignements – la pratique d’une activité physique, comme la marche à pied, par exemple.
Vie génitale
• Reproduction
Un fibrome n’entraîne qu’exceptionnellement une stérilité. Les fibromes seraient responsables de seulement 2 à 3 % des cas d’infécondité. Il s’agit surtout de fibromes très volumineux qui compriment les trompes de Fallope, ou de fibromes sous-muqueux qui gênent la nidation. En général, les fibromes interstitiels ou sous-séreux n’empêchent pas la survenue d’une grossesse. Cependant, toutes les techniques d’ablation ou de destruction de fibromes peuvent avoir une répercussion sur la fertilité : l’embolisation peut altérer la fonction ovarienne, la myomectomie et la myolyse peuvent être responsables d’adhérences intra-utérines.
• Grossesse
Dans la plupart des cas, la grossesse se déroule normalement. Mais les risques de douleurs pelviennes sont majorés du fait de l’augmentation du volume de l’utérus et de celui du fibrome.
Il existe toutefois quelques complications liées au fibrome : anomalie de l’insertion du placenta ou de la présentation de l’enfant à l’accouchement, nécessitant une surveillance échographique accrue et pouvant justifier un accouchement par césarienne, hausse du risque d’accouchement prématuré et d’hémorragies de la délivrance.
• Sexualité
Une ablation de l’utérus peut induire un sentiment de dévalorisation et de perte de l’identité féminine, et conduire à des troubles psycho-affectifs qui se répercutent sur la vie de couple. Il est donc important de rassurer les patientes : l’hystérectomie n’empêche pas les rapports sexuels. En revanche, il peut être utile de conseiller un soutien psychologique à celles qui vivent mal cette opération.
Tous nos remerciements au Dr Xavier Deffieux, chirurgien gynécologue, maître de conférences des universités, et praticien hospitalier à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart (92), pour son aimable relecture.
Le diagnostic des fibromes
• L’examen clinique évalue la forme et le volume de l’utérus et met en évidence une masse indolore et solidaire de l’utérus, grâce à un toucher vaginal et un palper abdominal.
• L’échographie est l’examen diagnostique de référence qui confirme le diagnostic. Idéalement réalisée en milieu de cycle, elle permet de préciser la localisation, le type et la taille du ou des fibromes.
• L’IRM peut être utile en cas de mauvaise échogénicité.
• L’hystéroscopie consiste à visualiser la cavité utérine au moyen d’un endoscope. Elle permet d’apprécier le retentissement des fibromes sous-muqueux dans la cavité utérine.
• L’hystéro-salpingographie est surtout pratiquée dans le cadre d’un bilan d’infertilité. Cet examen douloureux consiste à radiographier l’utérus et les trompes de Fallope, après injection endovaginale d’une substance radio-opaque.
La « castration chimique » sous analogues de la Gn-RH
Physiologiquement, la sécrétion d’oestrogènes par les ovaires dépend d’une stimulation hypothalamo-hypophysaire : l’hypothalamus sécrète de la Gn-RH stimulant la sécrétion de FSH et de LH par l’hypophyse, ce qui a pour effet de stimuler la sécrétion d’oestrogènes par les ovaires. Sous l’effet des analogues de la GN-RH, il y a d’abord une stimulation de l’hypophyse et des ovaires avec augmentation de sécrétion d’œstrogènes 1, ce qui a pour effet de déclencher, dans un second temps, un rétro-contrôle négatif avec inhibition de sécrétion de FSH et de LH 2, causant « une castration médicamenteuse » avec un arrêt des règles.
En savoir plusSite Fibrome utérin infos
Lancé en novembre 2009 en partenariat avec la Société française d’imagerie cardiaque et vasculaire (SFICV), ce site vise à répondre aux questions des patientes sur les différents fibromes, les symptômes, les facteurs de risque et les traitements.
- Formation à la vaccination : pas de DPC pour les préparateurs en 2025
- [VIDÉO] De la grossesse à la naissance : un accompagnement en officine personnalisé proposé par Amandine Greco, préparatrice
- [VIDÉO] Accompagnement post-natal en officine : les papas aussi !
- Entretiens pharmaceutiques en oncologie : tous concernés !
- Océane vient d’être diagnostiquée narcoleptique